| |
|
|
Père
RICHARD

|
 ON ne peut évoquer le
Domois de ce début de siècle sans parler du père Jacques Richard,
qui administra de 1908 à 1913, en tant que sous-directeur,
l’orphelinat de Domois, et directeur de 1913 à 1922. Il fut
un dévoué collaborateur du père Chanlon, et s’est lui aussi
usé au service de ses “petits gars”, comme il aimait à appeler
les enfants ; il était pour les orphelins un vrai père. Il
était certes sévère, même un peu de trop aux dires de certains
anciens, mais juste. Il était dur pour lui-même et aussi pour
les autres. Il ne tolérait aucune peccadille qui était impitoyablement
punie dans des proportions exagérées parfois.
ON ne peut évoquer le
Domois de ce début de siècle sans parler du père Jacques Richard,
qui administra de 1908 à 1913, en tant que sous-directeur,
l’orphelinat de Domois, et directeur de 1913 à 1922. Il fut
un dévoué collaborateur du père Chanlon, et s’est lui aussi
usé au service de ses “petits gars”, comme il aimait à appeler
les enfants ; il était pour les orphelins un vrai père. Il
était certes sévère, même un peu de trop aux dires de certains
anciens, mais juste. Il était dur pour lui-même et aussi pour
les autres. Il ne tolérait aucune peccadille qui était impitoyablement
punie dans des proportions exagérées parfois.
 Un ancien se souvient
:
Un ancien se souvient
:
Les
verbes entiers à copier plusieurs fois pleuvaient sur nos
têtes. Je me souviens que lors d’une de ses permissions,
en juillet 1916 (il avait 41 ans), alors que nous engrangions
les moissons, il nous surprit plusieurs de l’imprimerie,
“mobilisés” en cette circonstance, en train de jouer à cache-cache
sur les “tisses”. Il nous colla à copier cinq fois, pour
le lendemain, la phrase : “Je m’amuse au lieu de travailler”.
Le problème crucial était pour nous de trouver d’abord un
crayon et surtout du papier, difficulté à peu près insurmontable.
Que Dieu me pardonne ! mais nous étions obligés d’arracher
les pages blanches des missels pour exécuter notre punition
!
 Malgré cette sévérité
apparente, le père Richard a été un brave homme, aimé par
les orphelins. C’était sans aucun doute un homme charitable
et dévoué. Sa tâche à Domois consistait surtout à l’administration
et l’organisation. Les orphelins gardent un bon souvenir de
ce prêtre qui tenait toujours à accueillir les enfants, lorsqu’ils
arrivaient complètement désemparés, rue Condorcet à Dijon.
(Il est décédé en 1957, à l’âge de 84 ans).
Malgré cette sévérité
apparente, le père Richard a été un brave homme, aimé par
les orphelins. C’était sans aucun doute un homme charitable
et dévoué. Sa tâche à Domois consistait surtout à l’administration
et l’organisation. Les orphelins gardent un bon souvenir de
ce prêtre qui tenait toujours à accueillir les enfants, lorsqu’ils
arrivaient complètement désemparés, rue Condorcet à Dijon.
(Il est décédé en 1957, à l’âge de 84 ans).
 Ayant passé neuf années
à Domois, j’en ai entendu parler et en bien. Il avait pour
le soutenir des pères qui, pour la plupart, faisaient bien
leur travail.
Ayant passé neuf années
à Domois, j’en ai entendu parler et en bien. Il avait pour
le soutenir des pères qui, pour la plupart, faisaient bien
leur travail.
 Afin que leur dévouement
ne tombe pas dans l’oubli, j’aimerais en citer quelques-uns
: père Carré qui fût très certainement le bras droit du père
Richard. Les pères Braux, Albouy, Max, Perrot, Desvignes,
Pergent et bien d’autres dont les noms ne sont pas revenus
aux différents acteurs des articles.
Afin que leur dévouement
ne tombe pas dans l’oubli, j’aimerais en citer quelques-uns
: père Carré qui fût très certainement le bras droit du père
Richard. Les pères Braux, Albouy, Max, Perrot, Desvignes,
Pergent et bien d’autres dont les noms ne sont pas revenus
aux différents acteurs des articles.
 Des sœurs aussi œuvraient
et se donnaient corps et âme pour les orphelins. Mère Polycarpe,
tout en ayant la responsabilité d’une bonne douzaine de sœurs,
était d’un naturel effacé. Son abord était facile. Sa simplicité
n’avait d’égale que la gentillesse qu’elle exerçait sur les
enfants, ses “bébis tabageurs impéciles”, comme elle se plaisait
à les appeler. Car mère Polycarpe parlait très mal le français
et c’était là son plus grand défaut ; mais avec un peu de
bonne volonté les orphelins la comprenaient, du reste la plupart
des autres sœurs étaient alsaciennes. En dehors de sa charge
religieuse, mère Polycarpe s’occupait de la fabrication du
vin mousseux, marque “Maison Blanche” - sans doute à cause
du château, qui est aujourd’hui avec d’autres bâtiments, le
centre de l’orphelinat. Les bouteilles, coquettement vêtues
d’étiquettes blanches et or avec encadrement d’argent, muselées
à souhait et protégées par de mœlleux paillons, étaient expédiées
vers l’Alsace ou autres régions inconnues des enfants.
Des sœurs aussi œuvraient
et se donnaient corps et âme pour les orphelins. Mère Polycarpe,
tout en ayant la responsabilité d’une bonne douzaine de sœurs,
était d’un naturel effacé. Son abord était facile. Sa simplicité
n’avait d’égale que la gentillesse qu’elle exerçait sur les
enfants, ses “bébis tabageurs impéciles”, comme elle se plaisait
à les appeler. Car mère Polycarpe parlait très mal le français
et c’était là son plus grand défaut ; mais avec un peu de
bonne volonté les orphelins la comprenaient, du reste la plupart
des autres sœurs étaient alsaciennes. En dehors de sa charge
religieuse, mère Polycarpe s’occupait de la fabrication du
vin mousseux, marque “Maison Blanche” - sans doute à cause
du château, qui est aujourd’hui avec d’autres bâtiments, le
centre de l’orphelinat. Les bouteilles, coquettement vêtues
d’étiquettes blanches et or avec encadrement d’argent, muselées
à souhait et protégées par de mœlleux paillons, étaient expédiées
vers l’Alsace ou autres régions inconnues des enfants.
 Il est possible que des
sœurs soit oubliées dans ce récit, toujours est-il que je
reviendrai à parler d’un bon nombre d’entres elles dans les
différents souvenirs que les anciens ont fait parvenir.
Il est possible que des
sœurs soit oubliées dans ce récit, toujours est-il que je
reviendrai à parler d’un bon nombre d’entres elles dans les
différents souvenirs que les anciens ont fait parvenir.
|
Après
avoir présenté le père Chanlon et son œuvre, il serait
peut-être temps, avant d’évoquer sa succession, de parler
des orphelins, qui étaient les acteurs principaux de
l’existence de l’orphelinat de Domois. Là aussi, je
reprendrai des témoignages d’anciens qui ont à mon sens
dit ce que tous ont ressenti ou vécu.
|
 Mais revenons à notre
petit orphelin qui devait avoir son premier contact avec la
plus haute autorité de la maison.
Mais revenons à notre
petit orphelin qui devait avoir son premier contact avec la
plus haute autorité de la maison.
 L’orphelin qui arrivait
à Domois avait en général 9, 10 ans, c’était un enfant démuni
de tout qui n’avait même pas été choyé, aimé de ses parents
dans la plupart des cas d’ailleurs, c’était la mère qui était
décédée. Le père, bien souvent pauvre et sans emploi, ne pouvait
plus s’occuper de ses enfants et il devait se retourner, pour
lui venir en aide, uniquement vers des institutions charitables.
Au début de ce siècle, les prêtres des campagnes françaises
se sont dévoués pour venir au secours des familles qui se
trouvaient dans les situations les plus désespérées.
L’orphelin qui arrivait
à Domois avait en général 9, 10 ans, c’était un enfant démuni
de tout qui n’avait même pas été choyé, aimé de ses parents
dans la plupart des cas d’ailleurs, c’était la mère qui était
décédée. Le père, bien souvent pauvre et sans emploi, ne pouvait
plus s’occuper de ses enfants et il devait se retourner, pour
lui venir en aide, uniquement vers des institutions charitables.
Au début de ce siècle, les prêtres des campagnes françaises
se sont dévoués pour venir au secours des familles qui se
trouvaient dans les situations les plus désespérées.
 C’était en 1910 (j’avais
à peine 10 ans), ma pauvre maman mourait presque subitement
d’une paralysie foudroyante. Mon père me confia alors à ma
grand-mère maternelle qui avait une vie très pauvre, presque
misérable. Malgré la modeste pension que mon père lui servait,
elle ne put s’occuper bien longtemps de moi et, l’année suivante,
elle me renvoya vers lui : il avait entre-temps gagné Paris
où il travaillait. Là, nous occupions une modeste chambre
au cinquième étage d’un immeuble proche du restaurant où nous
prenions nos repas.
C’était en 1910 (j’avais
à peine 10 ans), ma pauvre maman mourait presque subitement
d’une paralysie foudroyante. Mon père me confia alors à ma
grand-mère maternelle qui avait une vie très pauvre, presque
misérable. Malgré la modeste pension que mon père lui servait,
elle ne put s’occuper bien longtemps de moi et, l’année suivante,
elle me renvoya vers lui : il avait entre-temps gagné Paris
où il travaillait. Là, nous occupions une modeste chambre
au cinquième étage d’un immeuble proche du restaurant où nous
prenions nos repas.
 J’ai eu la chance de voir
s’intéresser à moi la patronne qui me considéra tout de suite
comme “son enfant”, me prodiguant une grande bonté et me traitant
comme le frère de ses filles. Pendant près de deux ans, je
fus choyé par cette dame, mais mon père, gravement malade
et devant entrer à l’hôpital pour un long séjour, se décida
à me confier à un prêtre. Ce prêtre admirable, tout de bonté
et de dévouement, me garda quelques mois près de lui. Il m’assura
vivres et couvert et, ce qui est encore plus important, m’entoura
d’une véritable affection, ce qui rendait moins pénible ma
solitude. L’abbé Brunet, qui s’occupait également d’autres
enfants en difficulté, chercha à me placer dans une institution
où je pourrais me développer normalement et me préparer à
la vie
J’ai eu la chance de voir
s’intéresser à moi la patronne qui me considéra tout de suite
comme “son enfant”, me prodiguant une grande bonté et me traitant
comme le frère de ses filles. Pendant près de deux ans, je
fus choyé par cette dame, mais mon père, gravement malade
et devant entrer à l’hôpital pour un long séjour, se décida
à me confier à un prêtre. Ce prêtre admirable, tout de bonté
et de dévouement, me garda quelques mois près de lui. Il m’assura
vivres et couvert et, ce qui est encore plus important, m’entoura
d’une véritable affection, ce qui rendait moins pénible ma
solitude. L’abbé Brunet, qui s’occupait également d’autres
enfants en difficulté, chercha à me placer dans une institution
où je pourrais me développer normalement et me préparer à
la vie
 C’était par un bel après-midi
ensoleillé et chaud pour la saison, en février 1913. L’abbé
Brunet, mon bienfaiteur, qui m’accompagnait depuis Paris dans
un parcours assez long qui relie la capitale de la France
à celle de notre province, avait à la sortie de la gare de
Dijon hélé un fiacre, ou plutôt une calèche, qui nous mena
rue Condorcet où le père Richard nous accueillit et nous donna
rendez-vous à l’orphelinat de Domois distant d’une dizaine
de kilomètres. La route était agréable car, comme je l’ai
indiqué plus haut, le temps était magnifique, le soleil brillait
généreusement dans le ciel exempt de tout nuage. Le père Richard,
arrivé avant nous à destination, nous attendait près du “château”,
aile primitive du grand bâtiment actuel. Nous fûmes tout de
suite remarqués par les enfants qui se trouvaient à proximité,
car c’était un événement à Domois que de voir une voiture
de louage avec cocher !
C’était par un bel après-midi
ensoleillé et chaud pour la saison, en février 1913. L’abbé
Brunet, mon bienfaiteur, qui m’accompagnait depuis Paris dans
un parcours assez long qui relie la capitale de la France
à celle de notre province, avait à la sortie de la gare de
Dijon hélé un fiacre, ou plutôt une calèche, qui nous mena
rue Condorcet où le père Richard nous accueillit et nous donna
rendez-vous à l’orphelinat de Domois distant d’une dizaine
de kilomètres. La route était agréable car, comme je l’ai
indiqué plus haut, le temps était magnifique, le soleil brillait
généreusement dans le ciel exempt de tout nuage. Le père Richard,
arrivé avant nous à destination, nous attendait près du “château”,
aile primitive du grand bâtiment actuel. Nous fûmes tout de
suite remarqués par les enfants qui se trouvaient à proximité,
car c’était un événement à Domois que de voir une voiture
de louage avec cocher !
Rue
Condorcet

|
 Donc, le père Richard
nous fit visiter la Maison : les ateliers divers, classes,
réfectoires, dortoirs, et bien sûr, la chapelle qui nous avait
émerveillés avec ses décorations diverses et son ciel étoilé.
Tout de suite, j’avais été conquis par l’imprimerie : non
la composition, mais les machines, car “ça bougeait” et tout
ce qui est mécanique captive les enfants ; je me promettais
bien de travailler plus tard près de sœur Marie, grande maîtresse
de l’atelier d’impression, mais, - ironie du sort ! - c’est
vers la composition que l’on me dirigea l’année suivante,
en mai exactement, trois mois avant la déclaration de la Grande
Guerre 1914-1918 !
Donc, le père Richard
nous fit visiter la Maison : les ateliers divers, classes,
réfectoires, dortoirs, et bien sûr, la chapelle qui nous avait
émerveillés avec ses décorations diverses et son ciel étoilé.
Tout de suite, j’avais été conquis par l’imprimerie : non
la composition, mais les machines, car “ça bougeait” et tout
ce qui est mécanique captive les enfants ; je me promettais
bien de travailler plus tard près de sœur Marie, grande maîtresse
de l’atelier d’impression, mais, - ironie du sort ! - c’est
vers la composition que l’on me dirigea l’année suivante,
en mai exactement, trois mois avant la déclaration de la Grande
Guerre 1914-1918 !
 Après cette visite détaillée,
le père Richard me remit entre les mains de sœur Emma qui
s’occupait de la deuxième division ; elle me conduisit dans
la cour pour prendre contact avec mes futurs petits camarades,
car c’était l’heure de la récréation. Je fus intrigué de constater
que la plupart des enfants mangeaient leur pain sec, alors
que quelques-uns seulement agrémentaient leur goûter d’un
“cran” de chocolat. Je pensai donc que les premiers étaient
punis (je les trouvais trop nombreux), mais je fus bientôt
mis au courant et informé par l’un d’entre eux que le pain
sec était le régime habituel et que les mangeurs de chocolat
étaient les heureux bénéficiaires de colis reçus peu auparavant,
au moment des fêtes de fin d’année, et que sœur Emma leur
distribuait parcimonieusement... pour faire durer le plaisir
! Je me souviens que je possédais dans ma poche un œuf dur
(relief du repas pris dans le train), œuf que j’avais honte
de manger avec le morceau de pain que l’on m’avait donné,
et je l’offris à un “puni”, lequel ne se fit pas prier pour
l’accepter et le déguster.
Après cette visite détaillée,
le père Richard me remit entre les mains de sœur Emma qui
s’occupait de la deuxième division ; elle me conduisit dans
la cour pour prendre contact avec mes futurs petits camarades,
car c’était l’heure de la récréation. Je fus intrigué de constater
que la plupart des enfants mangeaient leur pain sec, alors
que quelques-uns seulement agrémentaient leur goûter d’un
“cran” de chocolat. Je pensai donc que les premiers étaient
punis (je les trouvais trop nombreux), mais je fus bientôt
mis au courant et informé par l’un d’entre eux que le pain
sec était le régime habituel et que les mangeurs de chocolat
étaient les heureux bénéficiaires de colis reçus peu auparavant,
au moment des fêtes de fin d’année, et que sœur Emma leur
distribuait parcimonieusement... pour faire durer le plaisir
! Je me souviens que je possédais dans ma poche un œuf dur
(relief du repas pris dans le train), œuf que j’avais honte
de manger avec le morceau de pain que l’on m’avait donné,
et je l’offris à un “puni”, lequel ne se fit pas prier pour
l’accepter et le déguster.
 L’abbé Brunet, qui avait
pris une légère collation dans la salle réservée aux visiteurs
près de la chapelle, vint me retrouver dans la cour pour me
faire ses adieux, me faisant force recommandations pour que
je me conduise bien afin que ma sagesse fût donnée en exemple
à mon entourage, ce que je lui promis sincèrement de faire.
L’abbé Brunet, qui avait
pris une légère collation dans la salle réservée aux visiteurs
près de la chapelle, vint me retrouver dans la cour pour me
faire ses adieux, me faisant force recommandations pour que
je me conduise bien afin que ma sagesse fût donnée en exemple
à mon entourage, ce que je lui promis sincèrement de faire.
Chapelle
de la Vierge

|
 Mon bienfaiteur demanda
- étant donné l’heure matinale à laquelle je m’étais levé
pour entreprendre le voyage du présent jour - que l’on me
fît manger et coucher avant les autres enfants et que l’on
m’accordât le lendemain matin, à titre exceptionnel, le bénéfice
d’une grasse matinée. Je me souviens de mon premier repas
(exécrable) : une affreuse soupe doublement ou triplement
salée, proprement immangeable et un plat de riz à l’eau qui
lui, ne l’était pas... salé, mais là pas du tout ; je trouvai
cela de mauvais augure, pour l’avenir.
Mon bienfaiteur demanda
- étant donné l’heure matinale à laquelle je m’étais levé
pour entreprendre le voyage du présent jour - que l’on me
fît manger et coucher avant les autres enfants et que l’on
m’accordât le lendemain matin, à titre exceptionnel, le bénéfice
d’une grasse matinée. Je me souviens de mon premier repas
(exécrable) : une affreuse soupe doublement ou triplement
salée, proprement immangeable et un plat de riz à l’eau qui
lui, ne l’était pas... salé, mais là pas du tout ; je trouvai
cela de mauvais augure, pour l’avenir.
 C’était un fâcheux pressentiment qui devait, hélas, s’avérer
par la suite malheureusement vrai. Puis une sœur me conduisit
au dortoir des “moyens” qui se trouvait au deuxième étage
mansardé du vieux bâtiment donnant sur la cour Saint-Joseph
et qui abritait également les réfectoires et dortoirs de la
petite division (10-11 ans), gouvernée par sœur BERTHA, ainsi
que l’école composée de deux classes, sans oublier la petite
infirmerie avec seulement deux chambres. Je me remémorais
les événements de la journée qui pouvaient compter pour un
enfant de douze ans, puis le sommeil s’empara de moi et je
m’endormis.
C’était un fâcheux pressentiment qui devait, hélas, s’avérer
par la suite malheureusement vrai. Puis une sœur me conduisit
au dortoir des “moyens” qui se trouvait au deuxième étage
mansardé du vieux bâtiment donnant sur la cour Saint-Joseph
et qui abritait également les réfectoires et dortoirs de la
petite division (10-11 ans), gouvernée par sœur BERTHA, ainsi
que l’école composée de deux classes, sans oublier la petite
infirmerie avec seulement deux chambres. Je me remémorais
les événements de la journée qui pouvaient compter pour un
enfant de douze ans, puis le sommeil s’empara de moi et je
m’endormis.
 Je me réveillai le lendemain matin en entendant les enfants
se lever de bonne heure, sans causer entre eux (car le silence
était de règle), mais non sans bruit. Je pensai avec plaisir
que j’allais bénéficier d’une ou plusieurs heures de répit,
suivant les instructions données à sœur PERPETUE la veille.
Je me réveillai le lendemain matin en entendant les enfants
se lever de bonne heure, sans causer entre eux (car le silence
était de règle), mais non sans bruit. Je pensai avec plaisir
que j’allais bénéficier d’une ou plusieurs heures de répit,
suivant les instructions données à sœur PERPETUE la veille.
 Cette sœur était chargée du lever des enfants, mais n’ayant
pas la compréhension facile et s’imaginant qu’un quart d’heure
supplémentaire équivalait à une grasse matinée, elle m’invita
à me lever après ce court délai et à rejoindre mes camarades
qui procédaient à une toilette sommaire, et faisaient fi des
règles de l’hygiène la plus élémentaire.
Cette sœur était chargée du lever des enfants, mais n’ayant
pas la compréhension facile et s’imaginant qu’un quart d’heure
supplémentaire équivalait à une grasse matinée, elle m’invita
à me lever après ce court délai et à rejoindre mes camarades
qui procédaient à une toilette sommaire, et faisaient fi des
règles de l’hygiène la plus élémentaire.
 Je quittai donc mon “lit” non sans récriminations, puis je
me livrai à un rapide débarbouillage et accompagnai tout ce
petit monde d’abord à la chapelle pour assister à la messe
quotidienne, puis au réfectoire où une soupe un peu plus appétissante
que la veille nous fut servie. Après quoi, en rang et en silence,
on nous conduisit à l’école où je fus présenté à ce brave
M. Carré (grand distributeur “d’oignons”), qui s’occupait
des aînés et voulut bien m’intégrer parmi les élèves de sa
classe.
Je quittai donc mon “lit” non sans récriminations, puis je
me livrai à un rapide débarbouillage et accompagnai tout ce
petit monde d’abord à la chapelle pour assister à la messe
quotidienne, puis au réfectoire où une soupe un peu plus appétissante
que la veille nous fut servie. Après quoi, en rang et en silence,
on nous conduisit à l’école où je fus présenté à ce brave
M. Carré (grand distributeur “d’oignons”), qui s’occupait
des aînés et voulut bien m’intégrer parmi les élèves de sa
classe.
 La première journée se passa sans incident notable. A remarquer
cependant qu’après la récréation de 10 heures, sœur Emma me
mena à la salle de couture et, derechef m’indiqua la manière
de repriser les chaussettes agrémentées de trous formidables
et ce, grâce à l’aide de boules ou d'œufs en bois. Je devais
par la suite devenir assez habile dans ce genre de travail,
puisque l’on me confia la charge de remettre en état les bas
du père Carré, ce qui me valut quelques gâteries (bonbons,
chocolat ou gâteaux) de sa part.
La première journée se passa sans incident notable. A remarquer
cependant qu’après la récréation de 10 heures, sœur Emma me
mena à la salle de couture et, derechef m’indiqua la manière
de repriser les chaussettes agrémentées de trous formidables
et ce, grâce à l’aide de boules ou d'œufs en bois. Je devais
par la suite devenir assez habile dans ce genre de travail,
puisque l’on me confia la charge de remettre en état les bas
du père Carré, ce qui me valut quelques gâteries (bonbons,
chocolat ou gâteaux) de sa part.
 J’eus la chance d’arriver à Domois à la fin février, donc
après les grands froids, car je devais apprendre par la suite
ce qu’était un hiver à Domois.
J’eus la chance d’arriver à Domois à la fin février, donc
après les grands froids, car je devais apprendre par la suite
ce qu’était un hiver à Domois.
 Heureux jeunes gens, pensionnaires actuels de l’orphelinat
et qui bénéficiez du chauffage central, sachez qu’à cette
époque, nous souffrions cruellement du froid en mauvaise saison
; à par les classes, salle de couture et ateliers où l’on
n’aurait rien pu faire avec ses doigts, il n’y avait de feu
nulle part. Pas de feu aux réfectoires (sauf dans celui des
tout-petits), ni aux dortoirs, ni à la chapelle, et les travailleurs
des champs et du jardin ne savaient guère ce que c’était de
se chauffer au cours des longs hivers. La vie était extrêmement
dure sous tout ses rapports (c’était vraiment “l’époque héroïque”.
La nourriture était la plupart du temps “immangeable” sauf
les jours de fête et en particulier le jour de la Saint-François
(29 janvier), fête du père Chanlon, où il était servi un repas
un peu plus amélioré.
Heureux jeunes gens, pensionnaires actuels de l’orphelinat
et qui bénéficiez du chauffage central, sachez qu’à cette
époque, nous souffrions cruellement du froid en mauvaise saison
; à par les classes, salle de couture et ateliers où l’on
n’aurait rien pu faire avec ses doigts, il n’y avait de feu
nulle part. Pas de feu aux réfectoires (sauf dans celui des
tout-petits), ni aux dortoirs, ni à la chapelle, et les travailleurs
des champs et du jardin ne savaient guère ce que c’était de
se chauffer au cours des longs hivers. La vie était extrêmement
dure sous tout ses rapports (c’était vraiment “l’époque héroïque”.
La nourriture était la plupart du temps “immangeable” sauf
les jours de fête et en particulier le jour de la Saint-François
(29 janvier), fête du père Chanlon, où il était servi un repas
un peu plus amélioré.
|
Voici
un autre témoignage de la période 1915-1920, tout aussi
intéressant et très enrichissant.
|
 Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué par l’arrivée
des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable et pénible
voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes petits camarades,
dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez, A. Varet, C.
Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les Dejonghe. Sœur
Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et leur garde était
vigilante et pleine de tendresse.
Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué par l’arrivée
des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable et pénible
voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes petits camarades,
dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez, A. Varet, C.
Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les Dejonghe. Sœur
Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et leur garde était
vigilante et pleine de tendresse.
 Huit jours de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux
et crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,
décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient
à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des
râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités
ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons
remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions
de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait
halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés
; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans
où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,
ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives
en robe jaune et Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué
par l’arrivée des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable
et pénible voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes
petits camarades, dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez,
A. Varet, C. Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les
Dejonghe. Sœur Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et
leur garde était vigilante et pleine de tendresse. Huit jours
de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux et
crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,
décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient
à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des
râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités
ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons
remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions
de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait
halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés
; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans
où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,
ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives
en robe jaune et nimbées de vapeur (c’est ainsi qu’un enfant
de 10 ans voyait les choses).
Huit jours de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux
et crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,
décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient
à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des
râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités
ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons
remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions
de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait
halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés
; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans
où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,
ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives
en robe jaune et Mon départ de Béthune fin 1914 fut provoqué
par l’arrivée des Allemands qui occupaient la région. Le lamentable
et pénible voyage de Béthune à Dijon, en compagnie de mes
petits camarades, dont je me rappelle quelques noms : P. Déprez,
A. Varet, C. Roussel, G. Petit, A. Loisel, H. Derelz, les
Dejonghe. Sœur Alice et sœur Isaie nous accompagnaient et
leur garde était vigilante et pleine de tendresse. Huit jours
de chemins de fer : wagons inconfortables, poussiéreux et
crasseux, à compartiments uniques, sans éclairage la nuit,
décès de vieilles personnes en cours de route, qui agonisaient
à côté de nous, au milieu des jurons en patois du Nord, des
râles et des plaintes ; incommodité de tous pour les nécessités
ordinaires, d’où nos pudeurs rentrées ; l’assaut des wagons
remplis de pommes, nos coliques faisant suite ; les distributions
de douceurs dans toutes les gares où notre convoi faisait
halte, les soupes et bouillons-gras et les tisanes pour émigrés
; nos figures hâves, sales, nos mains poisseuses : Orléans
où nous croupîmes quelques heures sur une voie de garage,
ainsi qu’un tas de bois ou de ferraille, parmi les locomotives
en robe jaune et nimbées de vapeur (c’est ainsi qu’un enfant
de 10 ans voyait les choses).
 L’arrivée à Nevers : la nuit passée sous les halles et repos
sur de la paille humide à souhait (dormeurs inconscients et
hideux au milieu des senteurs de poissons et de fromages :
véritable havre pour épaves humaines et fragiles jouets dans
les mains du sort) ; copieux repas, rue de l’Oratoire où l’on
mangea dans des assiettes creusées à même le bois des tables.
L’arrivée à Nevers : la nuit passée sous les halles et repos
sur de la paille humide à souhait (dormeurs inconscients et
hideux au milieu des senteurs de poissons et de fromages :
véritable havre pour épaves humaines et fragiles jouets dans
les mains du sort) ; copieux repas, rue de l’Oratoire où l’on
mangea dans des assiettes creusées à même le bois des tables.
 Enfin le voyage prit fin, et c’est très fatigués que nous
arrivâmes à Dijon au 40, rue Condorcet où nous fûmes vite
dirigés sur Préville. C’est à pied, par la route de Seurre
que nous arrivâmes à notre nouvelle demeure.
Enfin le voyage prit fin, et c’est très fatigués que nous
arrivâmes à Dijon au 40, rue Condorcet où nous fûmes vite
dirigés sur Préville. C’est à pied, par la route de Seurre
que nous arrivâmes à notre nouvelle demeure.
 Mon séjour à Préville, verte et opulente métairie où les sapins
et les arbres fruitiers sont rois, avec sa belle allée de
peupliers pointant haut vers le ciel (remplacés depuis par
des sapins maigres et mélancoliques), fût pour moi extrêmement
délicieux.
Mon séjour à Préville, verte et opulente métairie où les sapins
et les arbres fruitiers sont rois, avec sa belle allée de
peupliers pointant haut vers le ciel (remplacés depuis par
des sapins maigres et mélancoliques), fût pour moi extrêmement
délicieux.
 Sœur AMBROISE, personne fière, dévouée, intelligente,
dynamique, musicienne et dessinatrice hors ligne, portant
des lunettes à verres noirs et disant souvent de se méfier
des gens porteurs de lunettes de cette couleur (je sais gré
à cette bonne sœur de sa noble et artistique éducation), était
notre institutrice. M. Duthoit, aux petits yeux de
fouine, semblait toujours scruter un horizon chimérique ;
si ces lignes tombaient par hasard sous ses yeux, qu’il sache
que j’ai gardé de sa baguette protectrice tant à Béthune qu’à
Préville, “le meilleur souvenir” ! Et pour nous garder et
nous protéger, sœurs Alice, Isaie, Saint-Jean : anges vigilants
que la Providence désigna pour notre sauvegarde morale autant
que physique.
Sœur AMBROISE, personne fière, dévouée, intelligente,
dynamique, musicienne et dessinatrice hors ligne, portant
des lunettes à verres noirs et disant souvent de se méfier
des gens porteurs de lunettes de cette couleur (je sais gré
à cette bonne sœur de sa noble et artistique éducation), était
notre institutrice. M. Duthoit, aux petits yeux de
fouine, semblait toujours scruter un horizon chimérique ;
si ces lignes tombaient par hasard sous ses yeux, qu’il sache
que j’ai gardé de sa baguette protectrice tant à Béthune qu’à
Préville, “le meilleur souvenir” ! Et pour nous garder et
nous protéger, sœurs Alice, Isaie, Saint-Jean : anges vigilants
que la Providence désigna pour notre sauvegarde morale autant
que physique.
 A Préville nous étions bien et lorsque nous faisions trop
de bêtises, les sœurs nous disaient “Si vous n’êtes pas sages,
vous irez à Domois”. Cet avertissement, combien de fois l’avons-nous
entendu bourdonner à nos oreilles. A vrai dire : quotidiennement,
et cela pour des motifs futiles et quasi inexistants. Nous,
les enfants de Béthune, qui vivions depuis quelques mois dans
cette retraite toute pleine de verdure et de charme, encadrés
et protégés par un personnel sympathique et compréhensif,
bien nourris, presque choyés, il semblait dans nos petites
cervelles que le grand domaine du père Dediot était une succursale
du ciel et, de surcroît, un peu le nôtre. Là, après “l’enfer
du Nord”, nos vicissitudes, nos misères encore toutes fraîches
y trouvaient un baume bienfaisant et consolateur. Ah ! comme
nous eussions aimer demeurer dans ce Préville - véritable
Eldorado - longtemps, très longtemps.
A Préville nous étions bien et lorsque nous faisions trop
de bêtises, les sœurs nous disaient “Si vous n’êtes pas sages,
vous irez à Domois”. Cet avertissement, combien de fois l’avons-nous
entendu bourdonner à nos oreilles. A vrai dire : quotidiennement,
et cela pour des motifs futiles et quasi inexistants. Nous,
les enfants de Béthune, qui vivions depuis quelques mois dans
cette retraite toute pleine de verdure et de charme, encadrés
et protégés par un personnel sympathique et compréhensif,
bien nourris, presque choyés, il semblait dans nos petites
cervelles que le grand domaine du père Dediot était une succursale
du ciel et, de surcroît, un peu le nôtre. Là, après “l’enfer
du Nord”, nos vicissitudes, nos misères encore toutes fraîches
y trouvaient un baume bienfaisant et consolateur. Ah ! comme
nous eussions aimer demeurer dans ce Préville - véritable
Eldorado - longtemps, très longtemps.
Préville

|
 Hélas ! l’horizon n’était point rose. Convoyés par un vent
néfaste, des nuages tels qu’on en voit dans les cauchemars,
voilaient de tristesse chaque chose
Hélas ! l’horizon n’était point rose. Convoyés par un vent
néfaste, des nuages tels qu’on en voit dans les cauchemars,
voilaient de tristesse chaque chose
 A cette époque dont je vous parle, nous vivions dans une continuelle
et indécollable appréhension. La guerre n’en finissait plus.
L’espoir du retour à Béthune, déjà bien problématique, s’évanouissait
tout doucement... et définitivement. Certes, nous comprenions
aussi que l’existence privilégiée qui était notre lot ne pouvait
se prolonger éternellement.
A cette époque dont je vous parle, nous vivions dans une continuelle
et indécollable appréhension. La guerre n’en finissait plus.
L’espoir du retour à Béthune, déjà bien problématique, s’évanouissait
tout doucement... et définitivement. Certes, nous comprenions
aussi que l’existence privilégiée qui était notre lot ne pouvait
se prolonger éternellement.
 Ainsi parfois le provisoire n’est pas définitif (contrairement
à ce qui se passe très souvent), et comme les racontars chuchotés
soit par le laitier (à cette époque R. Chapuis) ou le messager
- ou même ce brave Joseph, porteur de gamelles - nous craignions
Domois plus que la guerre, jugez de notre état d’esprit du
moment et de la hantise que nous pouvions avoir de ce lieu
maudit par tous ! De plus, un élément psychologique venait
amplifier notre effroi. Nous savions par ouï-dire que notre
situation - notre façon de vivre - provoquait quelques jalousies
parmi la masse de nos futurs camarades. Le dimanche, quand
nous montions à Domois pour assister à la grand-messe, les
gars de l’orphelinat nous regardaient d’un mauvais œil. Nous
faisions figure d’intrus ; nous étions les favorisés, les
“fils à papa”, les étrangers en somme ; le pain qu’on nous
donnait était autant de portions en moins pour eux. Que sais-je
!... Rien qu’à entendre ce nom de Domois, nous éprouvions
tous un certain malaise. En toute impartialité disons que
le Domois de ce temps-là n’avait rien de très enviable en
fait de réputation. Donc, rien de comparable au Domois d’aujourd’hui.
En effet, pour quantité de gens, Domois était une maison de
correction où l’on enferme, pour les écarter de la société,
les enfants indisciplinés, délinquants ou voyous, à seule
fin de les re-dres-ser (si l’on peut dire).
Ainsi parfois le provisoire n’est pas définitif (contrairement
à ce qui se passe très souvent), et comme les racontars chuchotés
soit par le laitier (à cette époque R. Chapuis) ou le messager
- ou même ce brave Joseph, porteur de gamelles - nous craignions
Domois plus que la guerre, jugez de notre état d’esprit du
moment et de la hantise que nous pouvions avoir de ce lieu
maudit par tous ! De plus, un élément psychologique venait
amplifier notre effroi. Nous savions par ouï-dire que notre
situation - notre façon de vivre - provoquait quelques jalousies
parmi la masse de nos futurs camarades. Le dimanche, quand
nous montions à Domois pour assister à la grand-messe, les
gars de l’orphelinat nous regardaient d’un mauvais œil. Nous
faisions figure d’intrus ; nous étions les favorisés, les
“fils à papa”, les étrangers en somme ; le pain qu’on nous
donnait était autant de portions en moins pour eux. Que sais-je
!... Rien qu’à entendre ce nom de Domois, nous éprouvions
tous un certain malaise. En toute impartialité disons que
le Domois de ce temps-là n’avait rien de très enviable en
fait de réputation. Donc, rien de comparable au Domois d’aujourd’hui.
En effet, pour quantité de gens, Domois était une maison de
correction où l’on enferme, pour les écarter de la société,
les enfants indisciplinés, délinquants ou voyous, à seule
fin de les re-dres-ser (si l’on peut dire).
 De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous
on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de
faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,
de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).
Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances
physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît
l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit
de Noël.
De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous
on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de
faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,
de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).
Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances
physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît
l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit
de Noël.
 De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous
on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de
faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,
de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).
Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances
physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît
l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit
de Noël.
De plus, dans ce refuge campagnard isolé de tout et de tous
on y travaillait comme des mercenaires, on y “mourait” de
faim, et les caresses étaient données sous forme de gifles,
de brimades et de coups de toutes sortes (à ce qui se disait).
Ainsi les souffrances morales s’ajoutaient aux souffrances
physiques. Rien de surprenant alors pour nous que Domois fît
l’effet du martinet d’un père Fouettard en une belle nuit
de Noël.
 Mais il y a autre chose, bien plus révoltante encore : les
enfants dont la faute était d’avoir perdu leurs parents, ou
dont le père était mobilisé sur le front, ou abandonnés et
laissés pour compte se voyaient, pour cette raison, parés
du titre peu glorieux d’orphelins. Quand je dis : peu glorieux,
je songe à la pitié et aux sarcasmes que cette appellation
entraîne de la part de quelques imbéciles dont le seul mérite
est d’avoir tort en considérant le mot orphelin, à l’égal
du mot vaurien.
Mais il y a autre chose, bien plus révoltante encore : les
enfants dont la faute était d’avoir perdu leurs parents, ou
dont le père était mobilisé sur le front, ou abandonnés et
laissés pour compte se voyaient, pour cette raison, parés
du titre peu glorieux d’orphelins. Quand je dis : peu glorieux,
je songe à la pitié et aux sarcasmes que cette appellation
entraîne de la part de quelques imbéciles dont le seul mérite
est d’avoir tort en considérant le mot orphelin, à l’égal
du mot vaurien.
 Ils prononcent du reste ces deux mots avec le même haussement
d’épaule et le même sourire ironique comme s’ils étaient,
eux, des directeurs de conscience. Mais bah ! passons, puisque
tout passe et nous savons tous, nous orphelins que nous n’avons
jamais été des voyous ni des délinquants.
Ils prononcent du reste ces deux mots avec le même haussement
d’épaule et le même sourire ironique comme s’ils étaient,
eux, des directeurs de conscience. Mais bah ! passons, puisque
tout passe et nous savons tous, nous orphelins que nous n’avons
jamais été des voyous ni des délinquants.
 A certaines attentions délicates et subtiles de la part de
ceux et celles qui nous entouraient, nous devinions que notre
départ pour Domois était proche. Dès l’instant nous pouvions
donc cirer nos... souliers, et songer à quitter encore une
fois un lieu que déjà nous commencions d’aimer pour aller
grossir les rangs des “petits” ou des “moyens”. Sous quelle
tutelle, mon Dieu, allions-nous tomber ?
A certaines attentions délicates et subtiles de la part de
ceux et celles qui nous entouraient, nous devinions que notre
départ pour Domois était proche. Dès l’instant nous pouvions
donc cirer nos... souliers, et songer à quitter encore une
fois un lieu que déjà nous commencions d’aimer pour aller
grossir les rangs des “petits” ou des “moyens”. Sous quelle
tutelle, mon Dieu, allions-nous tomber ?
 Le jour où la décision fût prise, nous pleurions tous, même
les bonnes sœurs et M. Duthoit (la Vieille) notre surveillant.
Bien astiqués, des pieds à la tête, nous prîmes le sentier
poussiéreux et plein de fondrières qui mène à Domois. Ah !
ce jour de notre départ pour Domois ! Vous en souvenez-vous
mes chers camarades ! Combien il fut triste malgré le jour
ensoleillé ! Et combien aussi les adieux à Préville furent
sincères ! (Quand je dis “adieux” je devrais dire “au revoir”,
car la plupart d’entre nous y revîmmes plus tard et pour d’autres
raisons ).
Le jour où la décision fût prise, nous pleurions tous, même
les bonnes sœurs et M. Duthoit (la Vieille) notre surveillant.
Bien astiqués, des pieds à la tête, nous prîmes le sentier
poussiéreux et plein de fondrières qui mène à Domois. Ah !
ce jour de notre départ pour Domois ! Vous en souvenez-vous
mes chers camarades ! Combien il fut triste malgré le jour
ensoleillé ! Et combien aussi les adieux à Préville furent
sincères ! (Quand je dis “adieux” je devrais dire “au revoir”,
car la plupart d’entre nous y revîmmes plus tard et pour d’autres
raisons ).
 Nous fîmes donc nos adieux : au joli parc rempli d’arbres
et de bosquets de toutes espèces et égayés d’oiseaux ; au
grand verger aux fruits multiples qui invitaient à la maraude
; au vivier en surplomb serti de hauts sapins aux essences
si pures et à la petite source cachée dans une maisonnette
de pierres blanches ; aux chaudes écuries sentant bon la laine,
le lait et les tourteaux ; à la salle de classe où trônait
sœur Ambroise, le nez chaussé de lunettes noires ; au réfectoire
parfumé à la soupe et aux compotes de fruits ; au dortoir
situé sous les combles où nous aimions nous endormir bercés
par la chanson du vent, les bourrasques, la pluie, les hullulements
des chouettes et autres oiseaux nocturnes, etc... les plaintes
des sapins.
Nous fîmes donc nos adieux : au joli parc rempli d’arbres
et de bosquets de toutes espèces et égayés d’oiseaux ; au
grand verger aux fruits multiples qui invitaient à la maraude
; au vivier en surplomb serti de hauts sapins aux essences
si pures et à la petite source cachée dans une maisonnette
de pierres blanches ; aux chaudes écuries sentant bon la laine,
le lait et les tourteaux ; à la salle de classe où trônait
sœur Ambroise, le nez chaussé de lunettes noires ; au réfectoire
parfumé à la soupe et aux compotes de fruits ; au dortoir
situé sous les combles où nous aimions nous endormir bercés
par la chanson du vent, les bourrasques, la pluie, les hullulements
des chouettes et autres oiseaux nocturnes, etc... les plaintes
des sapins.
 Adieu à tout ce qui avait contribué à nous offrir un peu de
ce bonheur, si rare aux enfants délaissés. Adieu aussi - et
pourquoi pas ? - à cette musique monotone et énervante de
l’écrémeuse de sœur Hortense (où Crescence) qui n’en finissait
jamais de ronronner pendant les heures de classe et cela dans
une petite chambre puant le fromage et le lait battu où s’ébattaient
des milliers de mouches... Adieu enfin à cette belle allée
de peupliers aux fossés remplis de buissons d’épines où nous
cherchions les hérissons.
Adieu à tout ce qui avait contribué à nous offrir un peu de
ce bonheur, si rare aux enfants délaissés. Adieu aussi - et
pourquoi pas ? - à cette musique monotone et énervante de
l’écrémeuse de sœur Hortense (où Crescence) qui n’en finissait
jamais de ronronner pendant les heures de classe et cela dans
une petite chambre puant le fromage et le lait battu où s’ébattaient
des milliers de mouches... Adieu enfin à cette belle allée
de peupliers aux fossés remplis de buissons d’épines où nous
cherchions les hérissons.
 Finie la vie de pacha... A nous les rognes, la soupe aux layots,
la bouse de vache (épinards), les tuyaux (pâtes), la colle
(riz), les leutoches, les biscains (pas de traduction possible,
la langue domoisienne était particulière... si l’un de vous
se souvient, il peut me le faire savoir), la couenne jaune
importée d’Amérique (hé oui ! déjà), les péteux, les graillons,
etc... etc... Et cela pour une durée de cinq ans, une paille
!
Finie la vie de pacha... A nous les rognes, la soupe aux layots,
la bouse de vache (épinards), les tuyaux (pâtes), la colle
(riz), les leutoches, les biscains (pas de traduction possible,
la langue domoisienne était particulière... si l’un de vous
se souvient, il peut me le faire savoir), la couenne jaune
importée d’Amérique (hé oui ! déjà), les péteux, les graillons,
etc... etc... Et cela pour une durée de cinq ans, une paille
!
 Me voici donc installé près de sœur Emma ; je devais rester
dans sa division jusqu’à fin septembre 1915, alors que la
tradition aurait voulu que je passe chez les grands en janvier
de cette même année, date de mes 14 ans, mais la Grande Guerre
s’était déclenchée entre-temps, bouleversant le règlement
qui se ressentait de quelques entorses. Je ne me suis jamais
plaint de ce séjour prolongé chez les “moyens”, car ayant
entendu parler de brimades infligées par les anciens aux nouveaux
venus dans la grande section, j’appréhendais ce qui m’y attendait
de fâcheux.
Me voici donc installé près de sœur Emma ; je devais rester
dans sa division jusqu’à fin septembre 1915, alors que la
tradition aurait voulu que je passe chez les grands en janvier
de cette même année, date de mes 14 ans, mais la Grande Guerre
s’était déclenchée entre-temps, bouleversant le règlement
qui se ressentait de quelques entorses. Je ne me suis jamais
plaint de ce séjour prolongé chez les “moyens”, car ayant
entendu parler de brimades infligées par les anciens aux nouveaux
venus dans la grande section, j’appréhendais ce qui m’y attendait
de fâcheux.
 C’était un jeudi, jour de congé, je me revois encore dans
la salle de couture ; méthodiquement, je reprise des chaussettes
(chaussettes déjà reprisées plus de dix fois). Sous l’œil
attendri de Mme Manlay, je m’applique. Oui, je m’applique
- en entrelaçant la laine grise déboulée - à faire de superbes
grilles dont je martèle de temps en temps les bords : ceci
pour éviter des reliefs trop prononcés qui pourraient provoquer
aux pieds quelques désagréables durillons.
C’était un jeudi, jour de congé, je me revois encore dans
la salle de couture ; méthodiquement, je reprise des chaussettes
(chaussettes déjà reprisées plus de dix fois). Sous l’œil
attendri de Mme Manlay, je m’applique. Oui, je m’applique
- en entrelaçant la laine grise déboulée - à faire de superbes
grilles dont je martèle de temps en temps les bords : ceci
pour éviter des reliefs trop prononcés qui pourraient provoquer
aux pieds quelques désagréables durillons.
 Car, ne l’oublions pas, pour un “moyen”, repriser convenablement
des chaussettes est un art véritable - peut être le dixième
- et qui, fait de patience et de résignation, ouvre parfois
la porte à la rêverie. Tout les garçons de treize ans à Domois
doivent savoir repriser les chaussettes ; sans cela il y aurait
déshonneur et l’on serait “moyen” qu’à demi. Sacrebleu ! on
est “moyen” ou on ne l’est pas.
Car, ne l’oublions pas, pour un “moyen”, repriser convenablement
des chaussettes est un art véritable - peut être le dixième
- et qui, fait de patience et de résignation, ouvre parfois
la porte à la rêverie. Tout les garçons de treize ans à Domois
doivent savoir repriser les chaussettes ; sans cela il y aurait
déshonneur et l’on serait “moyen” qu’à demi. Sacrebleu ! on
est “moyen” ou on ne l’est pas.
 Le silence règne dans la salle. Un silence monacal, propice
à la prière. A peine entendrait-on une mouche voler. Car malheur
à celui qui oserait émettre un son, à plus forte raison faire
un quelconque bruit. On se retient même de tousser. Nous connaissons
bien la sentence portée contre le bavardage pour enfreindre
la règle du mutisme le plus complet ; elle est toujours la
même : pain sec et pas de récréation et... le nez au mur avec
les mains derrière le dos...
Le silence règne dans la salle. Un silence monacal, propice
à la prière. A peine entendrait-on une mouche voler. Car malheur
à celui qui oserait émettre un son, à plus forte raison faire
un quelconque bruit. On se retient même de tousser. Nous connaissons
bien la sentence portée contre le bavardage pour enfreindre
la règle du mutisme le plus complet ; elle est toujours la
même : pain sec et pas de récréation et... le nez au mur avec
les mains derrière le dos...
Orphelins
têtes nues
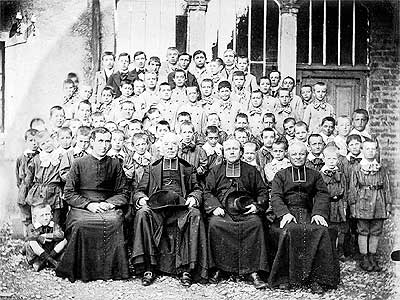
|
 Seuls les craquements des meubles branlants troublent parfois
la quiétude du lieu. Dans cette ruche où l’on œuvre avec patience
et résignation, il est facile de s’apercevoir que l’ennui
ronge les cœurs. Nos gestes sont toujours les mêmes ; établis
une bonne fois pour toutes, ils sont mé-ca-ni-ques, et aucun
de nous n’y voudrait rien changer. De plus, avec nos têtes
aux cheveux coupés ras et faisant un travail de “demoiselle”...
nous avons... piètre mine !
Seuls les craquements des meubles branlants troublent parfois
la quiétude du lieu. Dans cette ruche où l’on œuvre avec patience
et résignation, il est facile de s’apercevoir que l’ennui
ronge les cœurs. Nos gestes sont toujours les mêmes ; établis
une bonne fois pour toutes, ils sont mé-ca-ni-ques, et aucun
de nous n’y voudrait rien changer. De plus, avec nos têtes
aux cheveux coupés ras et faisant un travail de “demoiselle”...
nous avons... piètre mine !
 Ainsi se passaient les jeudis matin à Domois en ce temps-là
! Nous avions la coupe de cheveux chaque mois. Voici comment
cela se passait. Sœur Emma, armée de sa tondeuse, sacrifiait
une longue journée pour remettre les crânes à ras, et nous
ressemblions alors à des pensionnaires de Cayenne ou de Nouméa
(pénitenciers réputés des Français). Cette coupe, à la mode
aujourd’hui, nous rendait honteux et pas très beaux à voir.
Le lendemain, c’était la ruée à qui arriverait le premier
au lavabo préhistorique qui contenait un seau d’eau pour servir
aux 50 gosses que nous étions. Un mince filet coulait des
petits robinets ; les plus débrouillards se lavaient la tête
à l’eau propre et les autres dans la crasse des premiers,
qui séjournait dans le pourtour en zinc, car pas d’eau courante
! On peut comprendre pourquoi on nous tondait si souvent.
Ainsi se passaient les jeudis matin à Domois en ce temps-là
! Nous avions la coupe de cheveux chaque mois. Voici comment
cela se passait. Sœur Emma, armée de sa tondeuse, sacrifiait
une longue journée pour remettre les crânes à ras, et nous
ressemblions alors à des pensionnaires de Cayenne ou de Nouméa
(pénitenciers réputés des Français). Cette coupe, à la mode
aujourd’hui, nous rendait honteux et pas très beaux à voir.
Le lendemain, c’était la ruée à qui arriverait le premier
au lavabo préhistorique qui contenait un seau d’eau pour servir
aux 50 gosses que nous étions. Un mince filet coulait des
petits robinets ; les plus débrouillards se lavaient la tête
à l’eau propre et les autres dans la crasse des premiers,
qui séjournait dans le pourtour en zinc, car pas d’eau courante
! On peut comprendre pourquoi on nous tondait si souvent.
La
toilette

|
|
A
Domois, bien qu’il y eût un certain nombre de sœurs
et de pères pour s’occuper des orphelins, ils ne pouvaient
pas tout faire. Les “grands” en général étaient employés
à différentes tâches.
|
 Sœur
Cunégonde présidait au lavoir ; sœurs Renée et Fortuna s’affairaient
près des fourneaux ; sœurs Perpétue et Sébastien étaient assignées
aux travaux du jardin et sœur Alphonsia avait la tâche ingrate
de la porcherie. Sœur Marie-Louise, initiée au secret de la
fabrication du vin mousseux par mère Polycarpe, l’assistait
dans cette spécialité.
Sœur
Cunégonde présidait au lavoir ; sœurs Renée et Fortuna s’affairaient
près des fourneaux ; sœurs Perpétue et Sébastien étaient assignées
aux travaux du jardin et sœur Alphonsia avait la tâche ingrate
de la porcherie. Sœur Marie-Louise, initiée au secret de la
fabrication du vin mousseux par mère Polycarpe, l’assistait
dans cette spécialité.
 Toutes ces sœurs étaient dirigées par ladite mère ci-dessus
citée, elle-même chapeautée par mère Henriette, grande supérieure,
le plus souvent à Dijon, rue Condorcet.
Toutes ces sœurs étaient dirigées par ladite mère ci-dessus
citée, elle-même chapeautée par mère Henriette, grande supérieure,
le plus souvent à Dijon, rue Condorcet.
 Le père Chanlon, fréquemment absent de l’orphelinat (il avait
quand même 68 ans), était secondé par le père Richard, sous-directeur
; le père Carré, surveillant des grands, assumait les fonctions
d’instituteur. Il s’efforçait de nous donner les rudiments
d’une instruction primaire indispensable. Pour les rebelles
à l’assimilation, il usait et même abusait d’un moyen qu’il
jugeait infaillible et que nous appelions une distribution
“d’oignons” (coups répétés portés sur le crâne, et ce, à l’aide
de la main fermée).
Le père Chanlon, fréquemment absent de l’orphelinat (il avait
quand même 68 ans), était secondé par le père Richard, sous-directeur
; le père Carré, surveillant des grands, assumait les fonctions
d’instituteur. Il s’efforçait de nous donner les rudiments
d’une instruction primaire indispensable. Pour les rebelles
à l’assimilation, il usait et même abusait d’un moyen qu’il
jugeait infaillible et que nous appelions une distribution
“d’oignons” (coups répétés portés sur le crâne, et ce, à l’aide
de la main fermée).
 Par l’application de cette méthode entrèrent dans mon crâne
cabossé, et ce pour n’en plus jamais sortir, les accords des
participes passés selon leur (ou sans) auxiliaire. C’est ainsi
qu’à Domois, en cet an de grâce 1913, s’affirmait déjà l’efficacité
de la “force de frappe” !
Par l’application de cette méthode entrèrent dans mon crâne
cabossé, et ce pour n’en plus jamais sortir, les accords des
participes passés selon leur (ou sans) auxiliaire. C’est ainsi
qu’à Domois, en cet an de grâce 1913, s’affirmait déjà l’efficacité
de la “force de frappe” !
 Le père Braux s’occupait de la maîtrise qui était particulièrement
brillante à cette époque. Une fois par semaine, le jeudi,
avait lieu la classe de chant dirigée par lui ; il s’y montrait
sévère envers les retardataires qui connaissaient alors les
“douceurs” de la baguette de coudrier que ce prêtre maniait
magistralement.
Le père Braux s’occupait de la maîtrise qui était particulièrement
brillante à cette époque. Une fois par semaine, le jeudi,
avait lieu la classe de chant dirigée par lui ; il s’y montrait
sévère envers les retardataires qui connaissaient alors les
“douceurs” de la baguette de coudrier que ce prêtre maniait
magistralement.
 Il possédait un magnifique timbre de baryton et, aux jours
de grandes fêtes, nombreux étaient les habitants des communes
voisines qui venaient assister aux vêpres au cours desquelles
il interprétait avec talent un joli cantique, tel “Je suis
le Bon Pasteur”, la “Cantate à Jeanne d’Arc” et bien d’autres
où sa voix faisait merveille.
Il possédait un magnifique timbre de baryton et, aux jours
de grandes fêtes, nombreux étaient les habitants des communes
voisines qui venaient assister aux vêpres au cours desquelles
il interprétait avec talent un joli cantique, tel “Je suis
le Bon Pasteur”, la “Cantate à Jeanne d’Arc” et bien d’autres
où sa voix faisait merveille.
 Comme je vous le disais précédemment, nous étions très souvent
employés aux différentes tâches (corvées pour nous autres),
et les travaux des champs, du jardin et de la vigne étaient
les principaux. Le travail n’était pas désagréable en général,
c’est en hiver que nous souffrions le plus.
Comme je vous le disais précédemment, nous étions très souvent
employés aux différentes tâches (corvées pour nous autres),
et les travaux des champs, du jardin et de la vigne étaient
les principaux. Le travail n’était pas désagréable en général,
c’est en hiver que nous souffrions le plus.
 Nous participions aux plantations des pommes de terre, dédoublage
et piochage des betteraves, puis plus tard, rentrée des foins
et engrangeage des moissons, suivies du battage. Nous avions
pour nous surveiller une religieuse qui n’était pas tendre
envers nous : c’était une Allemande (Prussienne), qui s’appelait
sœur Dorothée ; elle ne nous goûtait guère, exigeant de nous
un travail acharné dans le rendement. Je me souviens de l’immense
champ de betteraves s’étendant de la ferme de Préville à la
garde-barrière (supprimée et remplacée par un pont actuellement),
avec des raies dont on ne voyait pas le bout. Nous étions
très fatigués le soir venu et nous étions heureux de retrouver
notre “plumard” (lit).
Nous participions aux plantations des pommes de terre, dédoublage
et piochage des betteraves, puis plus tard, rentrée des foins
et engrangeage des moissons, suivies du battage. Nous avions
pour nous surveiller une religieuse qui n’était pas tendre
envers nous : c’était une Allemande (Prussienne), qui s’appelait
sœur Dorothée ; elle ne nous goûtait guère, exigeant de nous
un travail acharné dans le rendement. Je me souviens de l’immense
champ de betteraves s’étendant de la ferme de Préville à la
garde-barrière (supprimée et remplacée par un pont actuellement),
avec des raies dont on ne voyait pas le bout. Nous étions
très fatigués le soir venu et nous étions heureux de retrouver
notre “plumard” (lit).
Les
enfants avec les outils

|
 Même si cette période était difficile pour tout le monde (n’oublions
pas que la France était en guerre), à Domois, nous avions
des moments qu’on pourrait appeler de fête. Grâce à la religion
dont se paraient nos éducateurs, nous pouvions manger un peu
mieux, nous divertir et nous reposer, au jour de l’an, le
29 janvier à la Saint-François (fête du père Chanlon) ; à
Pâques, le premier dimanche de mai, jour du pèlerinage de
Notre-Dame de Domois ; le 25 juillet, fête du père Richard
(la coutume voulait que l’on fête nos directeurs), et enfin
Noël, qui était très attendu comme dans tous les foyers du
monde, par les enfants.
Même si cette période était difficile pour tout le monde (n’oublions
pas que la France était en guerre), à Domois, nous avions
des moments qu’on pourrait appeler de fête. Grâce à la religion
dont se paraient nos éducateurs, nous pouvions manger un peu
mieux, nous divertir et nous reposer, au jour de l’an, le
29 janvier à la Saint-François (fête du père Chanlon) ; à
Pâques, le premier dimanche de mai, jour du pèlerinage de
Notre-Dame de Domois ; le 25 juillet, fête du père Richard
(la coutume voulait que l’on fête nos directeurs), et enfin
Noël, qui était très attendu comme dans tous les foyers du
monde, par les enfants.
 Noël était pour nous une fête qui nous permettait d’assister
à la messe de minuit - carillonnée par l’ami Avignant (ancien
et premier président de l’Amicale), maître sonneur chargé
d’annoncer les offices - et au cours de laquelle nous pouvions
communier, ensuite nous avions le bénéfice d’un vin chaud.
Au matin de Noël même grand-messe, et à midi, un bon repas.
Mais aussi une déception : pas d’arbre de Noël.
Noël était pour nous une fête qui nous permettait d’assister
à la messe de minuit - carillonnée par l’ami Avignant (ancien
et premier président de l’Amicale), maître sonneur chargé
d’annoncer les offices - et au cours de laquelle nous pouvions
communier, ensuite nous avions le bénéfice d’un vin chaud.
Au matin de Noël même grand-messe, et à midi, un bon repas.
Mais aussi une déception : pas d’arbre de Noël.
 Le jour de l’an, le matin, il y avait les vœux exprimés au
père supérieur, puis suivaient les chants et les saynètes
préparés par les orphelins. L’après-midi, tout rutilant de
boules multicolores et de guirlandes argentées, le sapin nous
attendait dans la salle des fêtes. Nous avions des numéros,
comme à la loterie : le plus veinard gagnait un beau jouet,
habituellement une machine à vapeur, et le plus mal servi
une chaîne de montre (sans montre !) ; à chacun était attribuées
quelques papillotes et oranges. Nous étions heureux.
Le jour de l’an, le matin, il y avait les vœux exprimés au
père supérieur, puis suivaient les chants et les saynètes
préparés par les orphelins. L’après-midi, tout rutilant de
boules multicolores et de guirlandes argentées, le sapin nous
attendait dans la salle des fêtes. Nous avions des numéros,
comme à la loterie : le plus veinard gagnait un beau jouet,
habituellement une machine à vapeur, et le plus mal servi
une chaîne de montre (sans montre !) ; à chacun était attribuées
quelques papillotes et oranges. Nous étions heureux.
 Pour la Saint-François, la fête était plus prestigieuse. Après
la messe de communion du matin à l’intention du père Chanlon,
nous nous réunissions pour la lecture du compliment. Puis,
après un bon repas, le meilleur de l’année (c’est Clément
Chartrain qui le dit, donc...), agrémenté de mousseux de la
“Maison Blanche”, c’était la séance récréative préparée par
la grande division et à laquelle assistaient, outre les orphelins
et la communauté, de nombreux habitants du hameau et des communes
voisines. C’était un plaisir inoubliable pour nous, privés
de toutes distractions (à part la lanterne magique que le
père Richard actionnait les dimanches d’hiver).
Pour la Saint-François, la fête était plus prestigieuse. Après
la messe de communion du matin à l’intention du père Chanlon,
nous nous réunissions pour la lecture du compliment. Puis,
après un bon repas, le meilleur de l’année (c’est Clément
Chartrain qui le dit, donc...), agrémenté de mousseux de la
“Maison Blanche”, c’était la séance récréative préparée par
la grande division et à laquelle assistaient, outre les orphelins
et la communauté, de nombreux habitants du hameau et des communes
voisines. C’était un plaisir inoubliable pour nous, privés
de toutes distractions (à part la lanterne magique que le
père Richard actionnait les dimanches d’hiver).
 Le pèlerinage à Notre-Dame de Domois avait lieu le premier
dimanche de mai (encore aujourd’hui) et c’était un grand jour
pour nous. Cela nous réjouissait beaucoup, car outre les grandioses
cérémonies religieuses, nous avions l’occasion de voir un
grand mouvement de foule avec la présence fidèle de la “Petite
Mère Chapelet” venue vendre médailles et images pieuses. Tout
ceci donnait de l’animation à notre vie monotone.
Le pèlerinage à Notre-Dame de Domois avait lieu le premier
dimanche de mai (encore aujourd’hui) et c’était un grand jour
pour nous. Cela nous réjouissait beaucoup, car outre les grandioses
cérémonies religieuses, nous avions l’occasion de voir un
grand mouvement de foule avec la présence fidèle de la “Petite
Mère Chapelet” venue vendre médailles et images pieuses. Tout
ceci donnait de l’animation à notre vie monotone.
 Il était de tradition, comme je le disais plus haut, de fêter
notre supérieur général, et le père Richard l’était. Cela
commençait par le repas du soir agrémenté cette fois d’un
dessert apprécié : les œufs à la neige. Puis nous nous rendions
dans la cour des “grands” où était donnée une séance récréative,
de nuit, en plein air (c’était en juillet).
Il était de tradition, comme je le disais plus haut, de fêter
notre supérieur général, et le père Richard l’était. Cela
commençait par le repas du soir agrémenté cette fois d’un
dessert apprécié : les œufs à la neige. Puis nous nous rendions
dans la cour des “grands” où était donnée une séance récréative,
de nuit, en plein air (c’était en juillet).
La
gymnastique

|
 Cette fête était un enchantement ; elle était due à l’initiative
du père Braux et de M. Paquet, instituteur et chef de la société
de gymnastique “l’Espérance de la Plaine”, qui se produisait
dans des mouvements d’ensemble très réussis, auxquels succédait
une petite comédie interprétée par nos camarades. Pour terminer
ces réjouissances, plusieurs “grands” faisaient partir, dans
la chaude soirée de juillet, de modestes pièces d’artifice
qui faisaient notre joie.
Cette fête était un enchantement ; elle était due à l’initiative
du père Braux et de M. Paquet, instituteur et chef de la société
de gymnastique “l’Espérance de la Plaine”, qui se produisait
dans des mouvements d’ensemble très réussis, auxquels succédait
une petite comédie interprétée par nos camarades. Pour terminer
ces réjouissances, plusieurs “grands” faisaient partir, dans
la chaude soirée de juillet, de modestes pièces d’artifice
qui faisaient notre joie.
 Mon passage chez les “grands” se passa fin septembre et mes
adieux envers les “moyens” se firent plus vite que la lumière.
Ma soupe avalée et mes draps usagés sous le bras, me voici
parti à la recherche du père Carré, de qui j’allais désormais
dépendre. Je rejoignis mon nouveau surveillant au réfectoire
des “grands” où il achevait son petit déjeuner ; je l’informai
que mère Polycarpe avait décidé de mon passage dans la grande
division (ce qu’il savait déjà, d’ailleurs) et que je me trouvais
sous sa “tutelle”. Il me conduisit alors à mon nouveau dortoir
où il m’indiqua le “lit” que j’occuperais désormais, puis
me fit un petit discours bien inutile (car j’étais fortement
intimidé par sa stature “confortable” et le souvenir de ses
distributions “d’oignons”) sur la nécessité pour moi de me
tenir tranquille afin d’éviter des punitions redoutables de
sa part.
Mon passage chez les “grands” se passa fin septembre et mes
adieux envers les “moyens” se firent plus vite que la lumière.
Ma soupe avalée et mes draps usagés sous le bras, me voici
parti à la recherche du père Carré, de qui j’allais désormais
dépendre. Je rejoignis mon nouveau surveillant au réfectoire
des “grands” où il achevait son petit déjeuner ; je l’informai
que mère Polycarpe avait décidé de mon passage dans la grande
division (ce qu’il savait déjà, d’ailleurs) et que je me trouvais
sous sa “tutelle”. Il me conduisit alors à mon nouveau dortoir
où il m’indiqua le “lit” que j’occuperais désormais, puis
me fit un petit discours bien inutile (car j’étais fortement
intimidé par sa stature “confortable” et le souvenir de ses
distributions “d’oignons”) sur la nécessité pour moi de me
tenir tranquille afin d’éviter des punitions redoutables de
sa part.
 J’appréhendais par avance l’accueil qui serait réservé par
les aînés de la grande division, mais je dois dire dès à présent
qu’il ne se passa rien de désagréable pour moi et que je fus
servi par un événement qui me concilia tout de suite l’amitié
des plus âgés ; ce sera le sujet de la seconde anecdote. Il
faut pourtant que j’informe les lecteurs que, dès la première
nuit , je dus me bagarrer avec les innombrables punaises qui
montaient en bataillons serrés à l’assaut de ma pourtant maigre
personne. Des punaises, je n’en ai jamais vu autant qu’à Domois,
et l’on dit qu’on ne trouve pas de ces indésirables bestioles
à la campagne ! Nous avons souffert beaucoup tous les ans
en période chaude (même moins chaude) et l’on se disputait
la veilleuse (lampe Pigeon) dont le principal usage était
de les rôtir !
J’appréhendais par avance l’accueil qui serait réservé par
les aînés de la grande division, mais je dois dire dès à présent
qu’il ne se passa rien de désagréable pour moi et que je fus
servi par un événement qui me concilia tout de suite l’amitié
des plus âgés ; ce sera le sujet de la seconde anecdote. Il
faut pourtant que j’informe les lecteurs que, dès la première
nuit , je dus me bagarrer avec les innombrables punaises qui
montaient en bataillons serrés à l’assaut de ma pourtant maigre
personne. Des punaises, je n’en ai jamais vu autant qu’à Domois,
et l’on dit qu’on ne trouve pas de ces indésirables bestioles
à la campagne ! Nous avons souffert beaucoup tous les ans
en période chaude (même moins chaude) et l’on se disputait
la veilleuse (lampe Pigeon) dont le principal usage était
de les rôtir !
Le
groupe des Soeurs à Préville

|
 La promesse donnée à l’abbé Brunet, mon bienfaiteur quelques
années auparavant, a été tenue, car je fus envoyé à l’imprimerie,
lieu où les “meilleurs” en orthographe étaient dirigés. C’est
pas qu’il y avait beaucoup à faire à la composition, la confection
du bulletin paroissial, une revue inoffensive pour jeune filles
(l’Idéale Jeunesse). Nous meublions les “creux” par des distractions
qui consistaient par exemple à orthographier à notre façon
les noms de gens que nous connaissions (la duchesse de Mortemart
qui devenait par nos soins Muortemuart). Des jeux divers et
plutôt simples, dont les principaux étaient : le “rapide”,
qui se trouvait être une caisse plate, installée sur le chariot
sur lequel habituellement on transportait les formes aux machines.
La promesse donnée à l’abbé Brunet, mon bienfaiteur quelques
années auparavant, a été tenue, car je fus envoyé à l’imprimerie,
lieu où les “meilleurs” en orthographe étaient dirigés. C’est
pas qu’il y avait beaucoup à faire à la composition, la confection
du bulletin paroissial, une revue inoffensive pour jeune filles
(l’Idéale Jeunesse). Nous meublions les “creux” par des distractions
qui consistaient par exemple à orthographier à notre façon
les noms de gens que nous connaissions (la duchesse de Mortemart
qui devenait par nos soins Muortemuart). Des jeux divers et
plutôt simples, dont les principaux étaient : le “rapide”,
qui se trouvait être une caisse plate, installée sur le chariot
sur lequel habituellement on transportait les formes aux machines.
 L’un de nous se mettait “à cropeton” dans ce mode de locomotion
et, à toute vitesse, un camarade le faisait circuler dans
les rangs ; il fallait, pour le passager, fermer les yeux
et deviner au moment de l’arrêt où il se trouvait.
L’un de nous se mettait “à cropeton” dans ce mode de locomotion
et, à toute vitesse, un camarade le faisait circuler dans
les rangs ; il fallait, pour le passager, fermer les yeux
et deviner au moment de l’arrêt où il se trouvait.
 Nous n’avions pas beaucoup de travail, c’est la raison pour
laquelle nous étions utilisés pour les travaux des champs,
lorsque cela le demandait. Mais nous avons pu quand même apprendre
notre métier et tous ont trouvé une situation à leur sortie
de Domois.
Nous n’avions pas beaucoup de travail, c’est la raison pour
laquelle nous étions utilisés pour les travaux des champs,
lorsque cela le demandait. Mais nous avons pu quand même apprendre
notre métier et tous ont trouvé une situation à leur sortie
de Domois.
 Il y avait même de très bons ouvriers qui sont arrivés à de
beaux postes, la preuve en est que, lorsque nous étions à
l’imprimerie dans ces années, nous eûmes la visite d’un ancien
élève de l’orphelinat, René Billoux qui, doué d’une grande
intelligence, était arrivé à une brillante situation : gérant
du “Bulletin des Maîtres-Imprimeurs de France”, et de plus
lauréat de l’Académie Française.
Il y avait même de très bons ouvriers qui sont arrivés à de
beaux postes, la preuve en est que, lorsque nous étions à
l’imprimerie dans ces années, nous eûmes la visite d’un ancien
élève de l’orphelinat, René Billoux qui, doué d’une grande
intelligence, était arrivé à une brillante situation : gérant
du “Bulletin des Maîtres-Imprimeurs de France”, et de plus
lauréat de l’Académie Française.
Les
ruines de Domois

|
|
A
Domois nous avions comme on vient de le voir de bons
moments et de moins bons, comme tous les enfants nous
nous en accommodions le mieux possible. Nos regrets
étaient enfouis dans nos cœurs qui parfois saignaient
dans le silence et la discrétion que chacun savait avoir.
Les anciens, malgré les souffrances qu’ils ont endurées
durant leur séjour à Domois, garderont toute leur reconnaissance
au père Chanlon. Il suffit de lire ce témoignage d’un
orphelin qui se veut anonyme, mais ce qu’il dit c’est
bien ce que pensent encore une fois ses camarades du
moment.
|
 Le père Chanlon, je le vois toujours au milieu de nous, souriant,
aimable. ; le père Chanlon en était plus malade que nous.
Il ne pouvait que donner ce qu’il avait pour 50, à plus de
cent personnes. Je n’ai pas trop souffert des privations qu’il
y avait au début En ce qui me concerne, je n’étais pas mieux
chez moi ; j’étais presque dans la rue. Toutes les personnes
que j’ai vues depuis m’ont dit que mon père était bon et bien
aimé, que ses affaires marchaient bien, qu’il avait un coffre
bien garni... Tout a été volé par des parents ; un groupe
a passé devant le tribunal de X... Mon défenseur, en plaidant
ma cause, a fait pleurer l’assistance en disant qu’ils avaient
volé, au berceau, de jeunes enfants. Le peu qui restait est
passé en frais. Personnellement, je dois beaucoup au père
Chanlon ; en écrivant ces lignes, j’ai les larmes aux yeux
; c’est pour nous que le père se dépensait tant. Je ne l’ai
jamais oublié.
Le père Chanlon, je le vois toujours au milieu de nous, souriant,
aimable. ; le père Chanlon en était plus malade que nous.
Il ne pouvait que donner ce qu’il avait pour 50, à plus de
cent personnes. Je n’ai pas trop souffert des privations qu’il
y avait au début En ce qui me concerne, je n’étais pas mieux
chez moi ; j’étais presque dans la rue. Toutes les personnes
que j’ai vues depuis m’ont dit que mon père était bon et bien
aimé, que ses affaires marchaient bien, qu’il avait un coffre
bien garni... Tout a été volé par des parents ; un groupe
a passé devant le tribunal de X... Mon défenseur, en plaidant
ma cause, a fait pleurer l’assistance en disant qu’ils avaient
volé, au berceau, de jeunes enfants. Le peu qui restait est
passé en frais. Personnellement, je dois beaucoup au père
Chanlon ; en écrivant ces lignes, j’ai les larmes aux yeux
; c’est pour nous que le père se dépensait tant. Je ne l’ai
jamais oublié.
 Malgré toutes ces vicissitudes, nous sommes sortis très
forts de l’orphelinat, heureux certes, mais assez craintifs
face à ce qui nous attendait dehors. Et l’on peut dire maintenant
que si le père Chanlon n’avait pas été là, que serions-nous
devenus ? Ce pionnier de la première heure, cet éducateur
de l’enfance déréglée - parce qu’abandonnée - était un véritable
apôtre, qu’on le veuille ou non. Parmi les quelque deux mille
enfants passés sous sa coupe, très peu ont “mal tourné”. Le
système d’éducation de l’orphelinat à cette époque avait tout
de même une certaine valeur...
Malgré toutes ces vicissitudes, nous sommes sortis très
forts de l’orphelinat, heureux certes, mais assez craintifs
face à ce qui nous attendait dehors. Et l’on peut dire maintenant
que si le père Chanlon n’avait pas été là, que serions-nous
devenus ? Ce pionnier de la première heure, cet éducateur
de l’enfance déréglée - parce qu’abandonnée - était un véritable
apôtre, qu’on le veuille ou non. Parmi les quelque deux mille
enfants passés sous sa coupe, très peu ont “mal tourné”. Le
système d’éducation de l’orphelinat à cette époque avait tout
de même une certaine valeur...
Ainsi vécurent les
orphelins des années
1900-1922.
Les
ruines de Domois

|
Le groupe des Soeurs

|
- retour haut -
|
|

