| |
|
|
Père
DEVRAINNE

|
 LE père Chanlon vieillissait
(il avait 75 ans), les pères et les sœurs également, ils commençaient,
il faut l’avouer, à être dépassés. La France se modernisait
et de nouvelles méthodes dans le monde de l’éducation commençaient
à prendre corps. Il fallait céder cette œuvre à d’autres,
qui dès 1922, prirent possession de l’orphelinat. Voici ce
qui s’est passé !
LE père Chanlon vieillissait
(il avait 75 ans), les pères et les sœurs également, ils commençaient,
il faut l’avouer, à être dépassés. La France se modernisait
et de nouvelles méthodes dans le monde de l’éducation commençaient
à prendre corps. Il fallait céder cette œuvre à d’autres,
qui dès 1922, prirent possession de l’orphelinat. Voici ce
qui s’est passé !
 C’est en 1921 que le très
bon père Déhon, fondateur et supérieur général de la
congrégation des prêtres du Sacré-Coeur de Saint-Quentin,
reçut un vibrant appel au secours du père Chanlon.
C’est en 1921 que le très
bon père Déhon, fondateur et supérieur général de la
congrégation des prêtres du Sacré-Coeur de Saint-Quentin,
reçut un vibrant appel au secours du père Chanlon.
Le
père DEHON

|
 Le père Déhon, au sens
social si averti, répond affirmativement et c’est cette même
année que les pères du Sacré-Cœur arrivent à Domois avec quelques
élèves de l’école de vocations tardives Saint-François-Xavier
qui, tout en continuant leurs études, assureront les surveillances
des enfants. L’œuvre de Domois, “son œuvre”, vivra !
Le père Déhon, au sens
social si averti, répond affirmativement et c’est cette même
année que les pères du Sacré-Cœur arrivent à Domois avec quelques
élèves de l’école de vocations tardives Saint-François-Xavier
qui, tout en continuant leurs études, assureront les surveillances
des enfants. L’œuvre de Domois, “son œuvre”, vivra !
 Le bon père Chanlon est
heureux ! Mais dans quel état les pères du Sacré-Cœur trouvent
l’orphelinat et les orphelins... Ecoutons le père Devrainne,
qui prit la direction de l’orphelinat.
Le bon père Chanlon est
heureux ! Mais dans quel état les pères du Sacré-Cœur trouvent
l’orphelinat et les orphelins... Ecoutons le père Devrainne,
qui prit la direction de l’orphelinat.
 Lorsque nous sommes arrivés à Domois, nous n’avons trouvé
qu’un seul prêtre, l’abbé Richard, qui était aidé par un prêtre
“amateur” Il n’avait comme personnel qu’une vieille institutrice
de plus de 61 ans et la sœur Marie qui surveillait le dortoir
et l’imprimerie.
Lorsque nous sommes arrivés à Domois, nous n’avons trouvé
qu’un seul prêtre, l’abbé Richard, qui était aidé par un prêtre
“amateur” Il n’avait comme personnel qu’une vieille institutrice
de plus de 61 ans et la sœur Marie qui surveillait le dortoir
et l’imprimerie.
 Ajoutons M. Morisot qui dirigeait l’imprimerie et M. Payen
qui était à la ferme. Cela faisait, avec trois autres sœurs,
chargées de la cuisine et du linge, huit personnes âgées et
plus ou moins expertes, pour prendre soin d’une centaine d’orphelins.
Il fallait également qu’elles s’occupent de la ferme, de l’imprimerie,
du jardin, etc... L’état du matériel et même moral était pitoyable.
Ajoutons M. Morisot qui dirigeait l’imprimerie et M. Payen
qui était à la ferme. Cela faisait, avec trois autres sœurs,
chargées de la cuisine et du linge, huit personnes âgées et
plus ou moins expertes, pour prendre soin d’une centaine d’orphelins.
Il fallait également qu’elles s’occupent de la ferme, de l’imprimerie,
du jardin, etc... L’état du matériel et même moral était pitoyable.
 Dès la première semaine j’ai dû faire remettre plus de cent
carreaux (que les petits orphelins avaient sans doute pris
pour cible à leurs heures de loisirs). Il n’y avait pas de
chauffage, en dehors de la salle de classe et de l’imprimerie
où il y avait un poêle au milieu de la pièce.
Dès la première semaine j’ai dû faire remettre plus de cent
carreaux (que les petits orphelins avaient sans doute pris
pour cible à leurs heures de loisirs). Il n’y avait pas de
chauffage, en dehors de la salle de classe et de l’imprimerie
où il y avait un poêle au milieu de la pièce.
 Il n’y avait pas d’électricité, juste un vieux système
à l’acétylène qui gelait chaque hiver, pour l’imprimerie et
les salles de classe. Le reste était éclairé avec des lampes
à pétrole ou parfois à la bougie.
Il n’y avait pas d’électricité, juste un vieux système
à l’acétylène qui gelait chaque hiver, pour l’imprimerie et
les salles de classe. Le reste était éclairé avec des lampes
à pétrole ou parfois à la bougie.
 Nous avons dès la deuxième année installé nous-mêmes, par
économie, l’électricité dans toute la maison.
Nous avons dès la deuxième année installé nous-mêmes, par
économie, l’électricité dans toute la maison.
 Ce fut le père Roblot qui dirigea les travaux. Les toitures
étaient dans un état lamentable, il pleuvait au réfectoire
et au dortoir...
Ce fut le père Roblot qui dirigea les travaux. Les toitures
étaient dans un état lamentable, il pleuvait au réfectoire
et au dortoir...
Le
père ROBLOT

|
 En constatant cet état de fait, le père Devrainne s’écria
: “On ne peut rester là !” Il y resta pourtant ! (encore un
homme qui avait la foi, pas uniquement envers son Dieu mais
aussi envers les enfants qui avaient besoin de lui).
En constatant cet état de fait, le père Devrainne s’écria
: “On ne peut rester là !” Il y resta pourtant ! (encore un
homme qui avait la foi, pas uniquement envers son Dieu mais
aussi envers les enfants qui avaient besoin de lui).
 La literie était infestée de punaises et notre premier travail,
le lendemain de notre arrivée, fut de passer nos lits au pétrole,
afin de les désinfecter. Les cabinets chez les orphelins consistaient
en une tinette disposée sur le palier mais qui, n’étant pas
vidée, laissait couler son trop plein dans tout l’escalier.
Au milieu du grand dortoir, un coin avec un trou servait de
grand cabinet. Les enfants marchaient pieds nus dans la...
marchandise et souillaient leurs draps.
La literie était infestée de punaises et notre premier travail,
le lendemain de notre arrivée, fut de passer nos lits au pétrole,
afin de les désinfecter. Les cabinets chez les orphelins consistaient
en une tinette disposée sur le palier mais qui, n’étant pas
vidée, laissait couler son trop plein dans tout l’escalier.
Au milieu du grand dortoir, un coin avec un trou servait de
grand cabinet. Les enfants marchaient pieds nus dans la...
marchandise et souillaient leurs draps.
 Le vestiaire des enfants était nul ou à peu près. Ils n’avaient
pas plus de deux chemises chacun et dans quel état ! A tel
point que lors d’une promenade où les enfants furent trempés,
nous avons été obligés de les mettre au lit complètement nus...
car ils n’avaient pas de rechange.
Le vestiaire des enfants était nul ou à peu près. Ils n’avaient
pas plus de deux chemises chacun et dans quel état ! A tel
point que lors d’une promenade où les enfants furent trempés,
nous avons été obligés de les mettre au lit complètement nus...
car ils n’avaient pas de rechange.
Le
groupe du père DEVRAINNE

|
 Le père Devrainne poursuit : Mgr Landrieux qui, au début était
très froid, devint un ami de Domois dans les années qui suivirent.
Il avait pourtant nommé le père Chanlon, chanoine titulaire
de la cathédrale de Dijon. Il attendait peut-être de voir
ce que ces jeunes prêtres, arrivant avec de nouvelles méthodes
de modernité, étaient capables de faire. Nous allons voir
qu’ils ont fait aussi beaucoup de choses pour le bien des
orphelins qu’ils aimaient.
Le père Devrainne poursuit : Mgr Landrieux qui, au début était
très froid, devint un ami de Domois dans les années qui suivirent.
Il avait pourtant nommé le père Chanlon, chanoine titulaire
de la cathédrale de Dijon. Il attendait peut-être de voir
ce que ces jeunes prêtres, arrivant avec de nouvelles méthodes
de modernité, étaient capables de faire. Nous allons voir
qu’ils ont fait aussi beaucoup de choses pour le bien des
orphelins qu’ils aimaient.
 Après avoir eu plusieurs rencontres avec notre évêque et lui
ayant expliqué la situation où se trouvait l’orphelinat et
ce que nous avions l’intention de faire, il changea son comportement
vis-à-vis de nous. Il m’invita même plusieurs fois à déjeuner,
ce qui me permit de lui rendre compte de l’avancement de notre
projet. Il n’était plus “honteux” m’a-t-il dit, quand il voyait
passer notre voiture dans Dijon, tellement le cheval et l’attelage
qui transportaient les enfants étaient autrefois misérables...
Après avoir eu plusieurs rencontres avec notre évêque et lui
ayant expliqué la situation où se trouvait l’orphelinat et
ce que nous avions l’intention de faire, il changea son comportement
vis-à-vis de nous. Il m’invita même plusieurs fois à déjeuner,
ce qui me permit de lui rendre compte de l’avancement de notre
projet. Il n’était plus “honteux” m’a-t-il dit, quand il voyait
passer notre voiture dans Dijon, tellement le cheval et l’attelage
qui transportaient les enfants étaient autrefois misérables...
 Voilà ! Comment débute la deuxième naissance de l’orphelinat
de Domois pris en charge par les pères du Sacré-Cœur.
Voilà ! Comment débute la deuxième naissance de l’orphelinat
de Domois pris en charge par les pères du Sacré-Cœur.
|
Au
jour où je relate ce qui s’est passé à Domois depuis
son ouverture, je ne possède pas grand chose concernant
la période des années 1922 à 1940. Mais je peux vous
présenter les témoignage d’anciens orphelins qui, comme
le premier sont dignes de foi, et où chacun pourra voir
en lui, le sien.
|
 Il faisait froid, l’automne 1927 tirait à sa fin. Un homme
grand, mince, une forte moustache aux pointes relevées, descendit
du train, traînant derrière lui un garçon d’une dizaine d’années.
Tous deux avaient l’air triste, comme si le temps avait déteint
sur eux. Pour le père, en effet, c’était la séparation : il
amenait le gamin pour le confier à des mains charitables,
mais étrangères. Le garçonnet, quant à lui, ne comprenait
pas encore, mais il pressentait que quelque chose allait se
passer qui ressemblerait à une catastrophe.
Il faisait froid, l’automne 1927 tirait à sa fin. Un homme
grand, mince, une forte moustache aux pointes relevées, descendit
du train, traînant derrière lui un garçon d’une dizaine d’années.
Tous deux avaient l’air triste, comme si le temps avait déteint
sur eux. Pour le père, en effet, c’était la séparation : il
amenait le gamin pour le confier à des mains charitables,
mais étrangères. Le garçonnet, quant à lui, ne comprenait
pas encore, mais il pressentait que quelque chose allait se
passer qui ressemblerait à une catastrophe.
 Jamais il n’avait quitté sa famille, ce gosse, ni son “pays”.
C’était la première fois qu’il prenait le train. Aussi, passée
la joie de monter dans ce véhicule étrange pour faire son
premier grand voyage - de Besançon à Dijon - une sorte d’inquiétude
l’envahissait.
Jamais il n’avait quitté sa famille, ce gosse, ni son “pays”.
C’était la première fois qu’il prenait le train. Aussi, passée
la joie de monter dans ce véhicule étrange pour faire son
premier grand voyage - de Besançon à Dijon - une sorte d’inquiétude
l’envahissait.
 Nous voici arrivés, dit le père ; il faut que nous trouvions
la maison des sœurs, pour qu’on t’emmène à Domois.
Nous voici arrivés, dit le père ; il faut que nous trouvions
la maison des sœurs, pour qu’on t’emmène à Domois.
 La catastrophe se précisait, confuse encore mais certaine.
La catastrophe se précisait, confuse encore mais certaine.
- La
maison des sœurs, rue Condorcet, s.v.p. Monsieur ?
-
Vous y êtes, mon brave Monsieur
; environ cent mètres sur le trottoir de droite ; vous verrez
un portail : c’est là.
-
C’est votre garçon ?
- Oui, c’est mon dernier.
- Bonjour M’sieur.
-
C’est pour Domois ? - Oui !
-
Oh, il sera très bien là-bas ; les pères et les soeurs y
sont très gentils. Tenez, je vais vous accompagner.
 Quelques minutes encore et nous voilà devant la résidence
des sœurs. Un coup de sonnette discret et notre charitable
compagnon annonce : - Une visite, c’est pour Domois.
Quelques minutes encore et nous voilà devant la résidence
des sœurs. Un coup de sonnette discret et notre charitable
compagnon annonce : - Une visite, c’est pour Domois.
 Une petite femme, la concierge, nous ouvre la porte, tandis
que l’inconnu prend congé poliment.
Une petite femme, la concierge, nous ouvre la porte, tandis
que l’inconnu prend congé poliment.
 Après les présentations d’usage, la petite vieille nous fait
entrer, mon père et moi, dans un petit parloir, nous disant
que nous n’aurions pas longtemps à attendre, le laitier devant
arriver d’un instant à l’autre.
Après les présentations d’usage, la petite vieille nous fait
entrer, mon père et moi, dans un petit parloir, nous disant
que nous n’aurions pas longtemps à attendre, le laitier devant
arriver d’un instant à l’autre.
 Et ce sont les dernières recommandations paternelles avant
la séparation. La femme avait dit vrai : j’entendis bientôt
un bruit de sabots venant de l’extérieur et un roulement de
carriole : roulement sourd, lent, presque lugubre, puis...
plus rien.
Et ce sont les dernières recommandations paternelles avant
la séparation. La femme avait dit vrai : j’entendis bientôt
un bruit de sabots venant de l’extérieur et un roulement de
carriole : roulement sourd, lent, presque lugubre, puis...
plus rien.
 De nouveau la sonnette s’agita et la porte cochère s’ouvrit
pour donner passage à un homme, jeune encore, moustache légère,
petit béret sur la tête, avec un accent traînant qui m’étonna
et me fit dévisager l’inconnu.
De nouveau la sonnette s’agita et la porte cochère s’ouvrit
pour donner passage à un homme, jeune encore, moustache légère,
petit béret sur la tête, avec un accent traînant qui m’étonna
et me fit dévisager l’inconnu.
-
Bonjour, Monsieur ; c’est vous qui amenez un orphelin à
Domois ?
 Ce mot “orphelin” je l’avais déjà entendu, mais jamais il
ne m’avait frappé comme à ce moment ; ce mot avait quelque
chose de dur, d’inhumain presque. Et mon papa ? Allait-il
m’abandonner lui aussi ? Ainsi, je n’avais plus de maman,
mais mon papa, lui, il n’était pas mort ; pourquoi allait-il
me laisser partir seul avec des inconnus ?
Ce mot “orphelin” je l’avais déjà entendu, mais jamais il
ne m’avait frappé comme à ce moment ; ce mot avait quelque
chose de dur, d’inhumain presque. Et mon papa ? Allait-il
m’abandonner lui aussi ? Ainsi, je n’avais plus de maman,
mais mon papa, lui, il n’était pas mort ; pourquoi allait-il
me laisser partir seul avec des inconnus ?
 J’en étais là dans mes réflexions amères, mais je n’eus pas
le temps de les approfondir.
J’en étais là dans mes réflexions amères, mais je n’eus pas
le temps de les approfondir.
 La soirée s’avançait, plus froide encore, plus lugubre aussi.
La soirée s’avançait, plus froide encore, plus lugubre aussi.
-
Allez, mon petit, au revoir, sois bien sage ; je reviendrai
bientôt pour te voir et demander aux sœurs si tu es gentil.
Au revoir mon chéri. A ce moment je sentis sur ma joue quelque
chose comme des larmes. Oui, mon père pleurait.
 D’un pas qu’il aurait voulu ferme, mon père en s’éloignant,
se retourna encore une fois : - Au revoir, mon petit, à bientôt
! La lourde porte se referma... mais elle se ferma pour toujours
sur mon pauvre père. Je ne devais plus le revoir sur terre.
D’un pas qu’il aurait voulu ferme, mon père en s’éloignant,
se retourna encore une fois : - Au revoir, mon petit, à bientôt
! La lourde porte se referma... mais elle se ferma pour toujours
sur mon pauvre père. Je ne devais plus le revoir sur terre.
 C’était donc bien vrai, c’était la catastrophe, la séparation,
l’abandon de ce qui restait de plus cher au gamin, sa dernière
affection. Mais ce qu’il ne comprenait pas - comment l’eut-il
compris, ce gosse - c’est que ce père qui semblait l’abandonner,
s’en allait lui aussi, écrasé par un immense chagrin : celui
de se séparer du dernier de ses enfants, après la disparition
de sa compagne de vie : douleur d’homme que le garçonnet ne
devait comprendre que bien plus tard, une fois devenu homme,
lui aussi.
C’était donc bien vrai, c’était la catastrophe, la séparation,
l’abandon de ce qui restait de plus cher au gamin, sa dernière
affection. Mais ce qu’il ne comprenait pas - comment l’eut-il
compris, ce gosse - c’est que ce père qui semblait l’abandonner,
s’en allait lui aussi, écrasé par un immense chagrin : celui
de se séparer du dernier de ses enfants, après la disparition
de sa compagne de vie : douleur d’homme que le garçonnet ne
devait comprendre que bien plus tard, une fois devenu homme,
lui aussi.
CHASSIGNET

|
 Hé oui ! Le père d’un orphelin était un homme comme les autres,
il avait du cœur et aimait ses enfants. Il se trouvait à ce
moment dans une impasse et ne pouvait absolument plus s’occuper,
élever, assurer un avenir normal à son enfant. Il pensait
sans arrière-pensée qu’il serait mieux entre les mains de
personnes étrangères et qu’il aurait une meilleure éducation
pour affronter sa vie d’adulte. Ce que ne savaient pas ces
pères, c’était l’immense vide sentimental qu’ils imposaient
à leurs enfants. Et c’est, je pense, ce qui les a le plus
marqués.
Hé oui ! Le père d’un orphelin était un homme comme les autres,
il avait du cœur et aimait ses enfants. Il se trouvait à ce
moment dans une impasse et ne pouvait absolument plus s’occuper,
élever, assurer un avenir normal à son enfant. Il pensait
sans arrière-pensée qu’il serait mieux entre les mains de
personnes étrangères et qu’il aurait une meilleure éducation
pour affronter sa vie d’adulte. Ce que ne savaient pas ces
pères, c’était l’immense vide sentimental qu’ils imposaient
à leurs enfants. Et c’est, je pense, ce qui les a le plus
marqués.
 Mais le temps s’assombrissait, et l’homme à la petite moustache
- vous l’avez tous reconnu, vous les anciens, Lucien (il avait
25 ans) le laitier - le chauffeur-livreur, le scieur, homme
à tout faire - ce brave en avait vu bien d’autres et il n’était
pas là pour faire du sentiment.
Mais le temps s’assombrissait, et l’homme à la petite moustache
- vous l’avez tous reconnu, vous les anciens, Lucien (il avait
25 ans) le laitier - le chauffeur-livreur, le scieur, homme
à tout faire - ce brave en avait vu bien d’autres et il n’était
pas là pour faire du sentiment.
- Allez,
petit, en route ! Et il me hissa dans la légendaire “voiture
du laitier”. Ici pas de débrayage, ni de changement automatique
; un pet, un petit tas de crottin tout chaud et hue ! nous
voilà partis.
-
Où c’est qu’on va, M’sieur ? C’est loin ?
-
On s’en va à Domois, tu vas trouver beaucoup de petits copains
là-bas.
 Je n’étais guère plus avancé ; de toute façon pour moi, c’était
l’inconnu. Je préférai me taire et me contentai de regarder
de-ci de-là les rares passants, la croupe arrondie du bourrin
et d’écouter le bruit des sabots sur la route solitaire.
Je n’étais guère plus avancé ; de toute façon pour moi, c’était
l’inconnu. Je préférai me taire et me contentai de regarder
de-ci de-là les rares passants, la croupe arrondie du bourrin
et d’écouter le bruit des sabots sur la route solitaire.
 Notre “traction avant” avait bien donné, et avant la nuit,
la carriole ralentissait, prenait une route à droite et s’engageait
sur un chemin montant, caillouteux, malaisé.
Notre “traction avant” avait bien donné, et avant la nuit,
la carriole ralentissait, prenait une route à droite et s’engageait
sur un chemin montant, caillouteux, malaisé.
-
On est arrivé, me dit l’homme.
 Mon cœur se mit à battre très fort, la peur m’envahit, l’envie
de pleurer me reprit à nouveau. Je me sentais en sécurité,
presque chez moi, dans cette voiture où le conducteur avait
pris soin de ramener sur nous le gros cuir qui nous recouvrait
jusqu’à mi-corps. Mais maintenant il allait falloir descendre,
marcher, parler, aller je ne sais où. Et à dix ans, on n’est
pas un homme ; les émotions de la journée m’avaient donné
un air qui faisait peine à voir.
Mon cœur se mit à battre très fort, la peur m’envahit, l’envie
de pleurer me reprit à nouveau. Je me sentais en sécurité,
presque chez moi, dans cette voiture où le conducteur avait
pris soin de ramener sur nous le gros cuir qui nous recouvrait
jusqu’à mi-corps. Mais maintenant il allait falloir descendre,
marcher, parler, aller je ne sais où. Et à dix ans, on n’est
pas un homme ; les émotions de la journée m’avaient donné
un air qui faisait peine à voir.
 Une petite cour plantée d’arbres, déjà pleine de nuit ; des
bruits confus de voix d’adolescents et d’enfants. Autour,
des bâtiments qui, à la faveur de la nuit, ne firent qu’augmenter
ma peine et mon angoisse. L’homme au petit béret, n’ayant
pas fini son labeur, me confia à un gamin plus âgé que moi,
qui, visiblement, était de la maison. Il parlait avec aisance,
il souriait même, et tout de suite ce sourire me rassura :
ça change si vite un enfant : le rire est près des larmes,
la joie voisine la douleur, comme la confiance voisine la
méfiance : le tout chevauchait dans le cœur du petit gars,
mais il ne savait encore à qui céder le pas, jusqu’au moment
où le gars de la maison lui avait dit gentiment :
Une petite cour plantée d’arbres, déjà pleine de nuit ; des
bruits confus de voix d’adolescents et d’enfants. Autour,
des bâtiments qui, à la faveur de la nuit, ne firent qu’augmenter
ma peine et mon angoisse. L’homme au petit béret, n’ayant
pas fini son labeur, me confia à un gamin plus âgé que moi,
qui, visiblement, était de la maison. Il parlait avec aisance,
il souriait même, et tout de suite ce sourire me rassura :
ça change si vite un enfant : le rire est près des larmes,
la joie voisine la douleur, comme la confiance voisine la
méfiance : le tout chevauchait dans le cœur du petit gars,
mais il ne savait encore à qui céder le pas, jusqu’au moment
où le gars de la maison lui avait dit gentiment :
-
Viens avec moi, t’as pas l’air d’avoir chaud, viens on va
se réchauffer. Et mi-souriant, mi-craintif, je le suivis
là où il y avait un bon feu qui sentait bon... à la porcherie.
 C’était vrai, je n’avais pas chaud, ni au cœur, ni au corps
: me sentir là, seul, au milieu d’inconnus, loin du pays où
papa s’en était allé, dans une maison qui me paraissait hostile.
Tout cela me glaçait plus que le froid de cette journée, qui
ne devait plus s’effacer de ma mémoire.
C’était vrai, je n’avais pas chaud, ni au cœur, ni au corps
: me sentir là, seul, au milieu d’inconnus, loin du pays où
papa s’en était allé, dans une maison qui me paraissait hostile.
Tout cela me glaçait plus que le froid de cette journée, qui
ne devait plus s’effacer de ma mémoire.
 J’en étais là de mes réflexions devant la grosse norvégienne
(marmite en fonte qui servait a cuire les pommes de terre
pour les cochons) quand l’homme, qui m’avait amené, vint nous
rejoindre. Alors, vous avez fait connaissance ? Ça va, vous
avez l’air de vous entendre. Mets ton manteau, on va aller
voir le père directeur ; vous ferez connaissance ; n’aie pas
peur, va, il n’est pas méchant. Je pris congé de mon hospitalier
porcher, le gars Pinger.
J’en étais là de mes réflexions devant la grosse norvégienne
(marmite en fonte qui servait a cuire les pommes de terre
pour les cochons) quand l’homme, qui m’avait amené, vint nous
rejoindre. Alors, vous avez fait connaissance ? Ça va, vous
avez l’air de vous entendre. Mets ton manteau, on va aller
voir le père directeur ; vous ferez connaissance ; n’aie pas
peur, va, il n’est pas méchant. Je pris congé de mon hospitalier
porcher, le gars Pinger.
PINGER

|
 Encore une figure de Domois qui est restée au service de l’orphelinat
durant de longues années. Il s’est occupé de la vacherie,
ce qui demandait beaucoup de responsabilités et de présence
pour assurer la traite de la vingtaine de vaches que l’orphelinat
possédait à ce moment-là. Il a été un fidèle serviteur de
l’orphelinat et s’est dépensé sans compter pour que les orphelins
ne manquent pas de lait chaque matin. Cet homme de cœur est
mort à Domois qu’il n’a jamais quitté et repose dans le petit
cimetière aux côtés des pères, sœurs et autres orphelins et
amis qu’il a connus.
Encore une figure de Domois qui est restée au service de l’orphelinat
durant de longues années. Il s’est occupé de la vacherie,
ce qui demandait beaucoup de responsabilités et de présence
pour assurer la traite de la vingtaine de vaches que l’orphelinat
possédait à ce moment-là. Il a été un fidèle serviteur de
l’orphelinat et s’est dépensé sans compter pour que les orphelins
ne manquent pas de lait chaque matin. Cet homme de cœur est
mort à Domois qu’il n’a jamais quitté et repose dans le petit
cimetière aux côtés des pères, sœurs et autres orphelins et
amis qu’il a connus.
|
Mais
revenons à notre petit orphelin qui devait avoir son
premier contact avec la plus haute autorité de la maison.
|
 J’emboîte le pas de l’homme au béret, nous traversons la cour
et nous nous engageons dans un escalier de pierre, sombre,
peu rassurant... et cela d’autant moins qu’au bout, il faudrait
affronter face à face mon premier grand personnage ; aussi
chaque marche m’enlevait-elle un peu de mon assurance. Arrivé
en haut, mes jambes tremblaient, mon cœur battait, j’enlevai
mon béret, ne sachant où le mettre, je le serrai bien fort
dans ma main et nous entrâmes..
J’emboîte le pas de l’homme au béret, nous traversons la cour
et nous nous engageons dans un escalier de pierre, sombre,
peu rassurant... et cela d’autant moins qu’au bout, il faudrait
affronter face à face mon premier grand personnage ; aussi
chaque marche m’enlevait-elle un peu de mon assurance. Arrivé
en haut, mes jambes tremblaient, mon cœur battait, j’enlevai
mon béret, ne sachant où le mettre, je le serrai bien fort
dans ma main et nous entrâmes..
-
Mon père, je vous amène le petit nouveau. Son père l’a amené
rue Condorcet et c’est là que je l’ai pris. Oui, son père
est reparti ; il a dit qu’il reviendrait dans quelques semaines
prendre des nouvelles.
 Lucien, je connaissais son nom maintenant, se retira, me laissant
seul avec un prêtre d’un certain âge, petit, trapu, le crâne
chauve entouré d’une couronne de cheveux blancs, drus et serrés.
La physionomie était très mobile. Visiblement c’était un petit
homme nerveux, avec qui il ne ferait pas bon avoir des histoires.
Les yeux surtout avaient attiré mon attention : des yeux marron,
profonds, vivants, scrutateurs, surmontés d’épais sourcils
grisonnants : tel était mon nouveau directeur, dont j’allais
bientôt apprendre le nom : le père Pergent, qui devait
décéder quelques années plus tard dans des circonstances très
particulières.
Lucien, je connaissais son nom maintenant, se retira, me laissant
seul avec un prêtre d’un certain âge, petit, trapu, le crâne
chauve entouré d’une couronne de cheveux blancs, drus et serrés.
La physionomie était très mobile. Visiblement c’était un petit
homme nerveux, avec qui il ne ferait pas bon avoir des histoires.
Les yeux surtout avaient attiré mon attention : des yeux marron,
profonds, vivants, scrutateurs, surmontés d’épais sourcils
grisonnants : tel était mon nouveau directeur, dont j’allais
bientôt apprendre le nom : le père Pergent, qui devait
décéder quelques années plus tard dans des circonstances très
particulières.
 Les formalités d’usage terminées, le père se leva et coiffa
son petit bonnet carré, une pèlerine noire sans capuchon et,
sans plus, me pria de le suivre. Il m’emmena tout droit au
réfectoire où le repas du soir allait avoir lieu.
Les formalités d’usage terminées, le père se leva et coiffa
son petit bonnet carré, une pèlerine noire sans capuchon et,
sans plus, me pria de le suivre. Il m’emmena tout droit au
réfectoire où le repas du soir allait avoir lieu.
 Mes tribulations ne faisaient que commencer : à peine m’avait-il
assigné une place que la porte s’ouvrait toute grande, laissant
pénétrer un flot de gamins, suivis d’adolescents qui, tous,
avaient l’air de savoir de quoi il s’agissait. Le repas des
jeunes carnassiers allait commencer. Dès que chacun eût gagné
la place qui lui était habituelle, une centaine de paires
d’yeux me dévisagèrent. Je ne savais plus où poser mon regard
; à droite, à gauche, partout des yeux de jeunes fauves qui
me dévoraient, comme si un intrus, entré par ruse, essayait
de leur ravir leur pitance. Des yeux curieux, plutôt méfiants,
en tout cas dénués d’aménité, sauf cependant pour les “grands”
où je n’étais pas un danger immédiat pour le “rab” de layos.
Section des moyens, le danger se rapprochait, mais il était
clair que celui-là, il était chez les petits.
Mes tribulations ne faisaient que commencer : à peine m’avait-il
assigné une place que la porte s’ouvrait toute grande, laissant
pénétrer un flot de gamins, suivis d’adolescents qui, tous,
avaient l’air de savoir de quoi il s’agissait. Le repas des
jeunes carnassiers allait commencer. Dès que chacun eût gagné
la place qui lui était habituelle, une centaine de paires
d’yeux me dévisagèrent. Je ne savais plus où poser mon regard
; à droite, à gauche, partout des yeux de jeunes fauves qui
me dévoraient, comme si un intrus, entré par ruse, essayait
de leur ravir leur pitance. Des yeux curieux, plutôt méfiants,
en tout cas dénués d’aménité, sauf cependant pour les “grands”
où je n’étais pas un danger immédiat pour le “rab” de layos.
Section des moyens, le danger se rapprochait, mais il était
clair que celui-là, il était chez les petits.
Le
froupe sur le perron de la cuisine

|
 A la section des petits où j’étais affecté, des regard d’envie
se posaient sur mes deux voisins immédiats : ils savaient,
eux ! Après la petite prière d’usage, ce fût un beau fracas
de pieds de bancs, qui prennent des positions bien définies
à l’avance : eux aussi rentraient en lice... Puis c’était
la danse des gamelles, les unes en fer blanc, des anciennes
aux creux profonds, aux bords bien relevés ; les autres en
aluminium brillant, des nouvelles, moins profondes mais plus
larges : elles étaient les plus recherchées, certains gredins
sans doute en ayant jaugé le volume. Et par hasard, j’en avais
une en “alu”.
A la section des petits où j’étais affecté, des regard d’envie
se posaient sur mes deux voisins immédiats : ils savaient,
eux ! Après la petite prière d’usage, ce fût un beau fracas
de pieds de bancs, qui prennent des positions bien définies
à l’avance : eux aussi rentraient en lice... Puis c’était
la danse des gamelles, les unes en fer blanc, des anciennes
aux creux profonds, aux bords bien relevés ; les autres en
aluminium brillant, des nouvelles, moins profondes mais plus
larges : elles étaient les plus recherchées, certains gredins
sans doute en ayant jaugé le volume. Et par hasard, j’en avais
une en “alu”.
 Elles se remplirent les unes après les autres. Avec une attention
délicate - et surtout intéressée - mon voisin, me remplit
mon écuelle à ras bords avec un petit sourire de contentement,
puis passa la soupière aux plus éloignés.
Elles se remplirent les unes après les autres. Avec une attention
délicate - et surtout intéressée - mon voisin, me remplit
mon écuelle à ras bords avec un petit sourire de contentement,
puis passa la soupière aux plus éloignés.
-
T’en veux ? me dit-il.
-
Oui, un peu.
-
C’est bon, tu sais ! - Oui.
 Et il éclata d’un grand rire, avant d’avaler la première cuillerée,
mais je n’avais pas compris. Je n’avais aucunement envie de
manger mais plutôt de pleurer, de vomir, de me sauver. Je
pris ma cuillère et la plongeai dans ma gamelle, tout en remuant,
tant pour me donner une contenance que pour me rendre compte
de ce qui allait être désormais “mon pain quotidien”. J’en
avalai bien la valeur de trois à cinq cuillères mais ça ne
voulait plus passer.
Et il éclata d’un grand rire, avant d’avaler la première cuillerée,
mais je n’avais pas compris. Je n’avais aucunement envie de
manger mais plutôt de pleurer, de vomir, de me sauver. Je
pris ma cuillère et la plongeai dans ma gamelle, tout en remuant,
tant pour me donner une contenance que pour me rendre compte
de ce qui allait être désormais “mon pain quotidien”. J’en
avalai bien la valeur de trois à cinq cuillères mais ça ne
voulait plus passer.
-
C’est bon ? me dit Chir, mon voisin.
-
Oui ! Il était visiblement persuadé du contraire.
- T’en veux plus ?
-
Non.
 Et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le contenu
de ma gamelle avait disparu dans la sienne. Par prudence,
il en avait laissé un petit fond, au cas où le surveillant,
le père Pergent lui-même, serait venu s’informer de mon appétit.
La chose ne manqua pas d’arriver mais à voir mon air de chien
battu et ma gamelle presque vide, je suis sûr que le bon père,
ce soir-là, ne se fit pas d’illusions, d’autant plus que mon
voisin, le nez plongé dans les layos, était en plein travail.
Ce lapement un peu prolongé chez mon compagnon aurait suffi
à éveiller de justes soupçons ; il avait souvent fini bon
premier ; au cas où il y aurait du “rab”, il ne fallait pas
être à la traîne.
Et en moins de temps qu’il n’en faut pour l’écrire, le contenu
de ma gamelle avait disparu dans la sienne. Par prudence,
il en avait laissé un petit fond, au cas où le surveillant,
le père Pergent lui-même, serait venu s’informer de mon appétit.
La chose ne manqua pas d’arriver mais à voir mon air de chien
battu et ma gamelle presque vide, je suis sûr que le bon père,
ce soir-là, ne se fit pas d’illusions, d’autant plus que mon
voisin, le nez plongé dans les layos, était en plein travail.
Ce lapement un peu prolongé chez mon compagnon aurait suffi
à éveiller de justes soupçons ; il avait souvent fini bon
premier ; au cas où il y aurait du “rab”, il ne fallait pas
être à la traîne.
 Le repas s’acheva sans histoire ; d’ailleurs, j’avais hâte
de sortir respirer un bol d’air frais. Quelqu’un que je n’avais
pas encore vu, nous prit en charge dès la sortie :
Le repas s’acheva sans histoire ; d’ailleurs, j’avais hâte
de sortir respirer un bol d’air frais. Quelqu’un que je n’avais
pas encore vu, nous prit en charge dès la sortie :
-
Frère, y a un nouveau ici.
- Je sais, je sais, dit le frère, mettez-vous un peu en
rang ; regardez-moi cette pagaie. Chir, Prétet, à genoux
au pied de votre lit !
 C’était le frère Alphonse Petit qui avait parlé.
C’était le frère Alphonse Petit qui avait parlé.
 Je pensai, à part moi : - Bon, après ce brouet spartiate,
voilà des punitions à présent. Je ravalai ma salive et montai
l’escalier de bois conduisant au dortoir des petits, où une
autre personne nous attendait, les mains aux hanches un trousseau
de clés pendant aux doigts. Mais ce n’était plus un homme
en noir, c’était une sœur, trapue, carrée, taillée à la hache,
le voile et la guimpe bien posés sur un front volontaire bien
sûr : c’était la sœur Marie, une maîtresse femme. Elle m’assigna
une place et me dit d’un fort accent alsacien :
Je pensai, à part moi : - Bon, après ce brouet spartiate,
voilà des punitions à présent. Je ravalai ma salive et montai
l’escalier de bois conduisant au dortoir des petits, où une
autre personne nous attendait, les mains aux hanches un trousseau
de clés pendant aux doigts. Mais ce n’était plus un homme
en noir, c’était une sœur, trapue, carrée, taillée à la hache,
le voile et la guimpe bien posés sur un front volontaire bien
sûr : c’était la sœur Marie, une maîtresse femme. Elle m’assigna
une place et me dit d’un fort accent alsacien :
-
Est-ce que tu fais au lit ?
-
Quelquefois, ma sœur, dis-je timidement.
- Ah ! il faut plus faire, sinon “fieu”, on ne sera pas
bons amis.
 En m’enfilant dans mes draps, je me jurai de faire attention.
Il est toujours désagréable de s’attirer des ennuis et de
se signaler à l’attention publique quand on arrive dans une
maison.
En m’enfilant dans mes draps, je me jurai de faire attention.
Il est toujours désagréable de s’attirer des ennuis et de
se signaler à l’attention publique quand on arrive dans une
maison.
 Pour un gamin comme moi, la journée avait été longue, pleine
d’embûches, riche en émotions. Aussi, je ne tardai pas à m’endormir
d’un sommeil qu’on ne connaît qu’à cet âge. Je dormis profondément.
Mais le lendemain matin, mon réveil fut un cauchemar, quand
je me sentis... dans le lac. Je changeai de position, pensant
faire office de fer à repasser, imaginant que d’ici le lever,
il n’y aurait plus de traces. Je m’évertuais, mais en vain
! Un tour de clé dans la serrure de la petite cellule contiguë
à mon lit me fit comprendre que j’étais perdu : la sœur au
trousseau de clés sortait. J’ignorais encore tout des coutumes
de la maison. Tout restait calme, personne ne bougeait ; sans
doute n’était-il pas encore l’heure. La silhouette noire et
blanche s’avança silencieusement, en s’arrêtant avec une précision
qu’on aurait dit automatique, devant certains lits. Un bruit
de ressorts qui grincent, des couvertures qui volent et v’lan
: c’est la discipline en cordelettes de sœur Marie qui s’abat
sur... les délinquants de la nuit.
Pour un gamin comme moi, la journée avait été longue, pleine
d’embûches, riche en émotions. Aussi, je ne tardai pas à m’endormir
d’un sommeil qu’on ne connaît qu’à cet âge. Je dormis profondément.
Mais le lendemain matin, mon réveil fut un cauchemar, quand
je me sentis... dans le lac. Je changeai de position, pensant
faire office de fer à repasser, imaginant que d’ici le lever,
il n’y aurait plus de traces. Je m’évertuais, mais en vain
! Un tour de clé dans la serrure de la petite cellule contiguë
à mon lit me fit comprendre que j’étais perdu : la sœur au
trousseau de clés sortait. J’ignorais encore tout des coutumes
de la maison. Tout restait calme, personne ne bougeait ; sans
doute n’était-il pas encore l’heure. La silhouette noire et
blanche s’avança silencieusement, en s’arrêtant avec une précision
qu’on aurait dit automatique, devant certains lits. Un bruit
de ressorts qui grincent, des couvertures qui volent et v’lan
: c’est la discipline en cordelettes de sœur Marie qui s’abat
sur... les délinquants de la nuit.
 Ce jour-là je fus épargné... mais pas les autres jours. La
tournée générale terminée, sœur Marie tapait dans ses mains
; c’était le signal d’une nouvelle journée...
Ce jour-là je fus épargné... mais pas les autres jours. La
tournée générale terminée, sœur Marie tapait dans ses mains
; c’était le signal d’une nouvelle journée...
 Voilà comment des enfants, traumatisés sans doute par
ce qui leur arrivaient et n’ayant eu aucune approche et entretien
préalables, qui auraient peut-être pu atténuer un tant soit
peu cette nouvelle situation, étaient traités en ce début
de siècle. Il ne faut pas voir par cette remarque du rédacteur
le reproche envers les sœurs qui, je le maintiens, faisaient
ce qu’elles pouvaient. Elles ignoraient très certainement
que cet état de fait était dû à un problème de muscle annulaire
fermant un orifice.
Voilà comment des enfants, traumatisés sans doute par
ce qui leur arrivaient et n’ayant eu aucune approche et entretien
préalables, qui auraient peut-être pu atténuer un tant soit
peu cette nouvelle situation, étaient traités en ce début
de siècle. Il ne faut pas voir par cette remarque du rédacteur
le reproche envers les sœurs qui, je le maintiens, faisaient
ce qu’elles pouvaient. Elles ignoraient très certainement
que cet état de fait était dû à un problème de muscle annulaire
fermant un orifice.
 Mais notre ami tient à dire aux mamans qui pourraient
nous lire, et qui auraient des enfants atteints de cette petite
faiblesse... du sphincter, que les coups de cordelettes ne
changeaient rien à l’affaire. Un conseil : pas de matelas
pour ce genre d’exercice nocturne, mais une bonne paillasse,
renouvelable à souhait (ce que les enfants atteints de cette
maladie, auront par la suite, et qui ne réglera pas complètement
leur situation, car ils étaient quand même considérés un peu
comme des “parias” aux yeux de leurs camarades) une alèse
au besoin et surtout... un peu de patience et beaucoup d’amour
feront que vos enfants n’auront pas un réveil angoissé, ni
un complexe d’infériorité dont ils auront longtemps à souffrir.
Mais notre ami tient à dire aux mamans qui pourraient
nous lire, et qui auraient des enfants atteints de cette petite
faiblesse... du sphincter, que les coups de cordelettes ne
changeaient rien à l’affaire. Un conseil : pas de matelas
pour ce genre d’exercice nocturne, mais une bonne paillasse,
renouvelable à souhait (ce que les enfants atteints de cette
maladie, auront par la suite, et qui ne réglera pas complètement
leur situation, car ils étaient quand même considérés un peu
comme des “parias” aux yeux de leurs camarades) une alèse
au besoin et surtout... un peu de patience et beaucoup d’amour
feront que vos enfants n’auront pas un réveil angoissé, ni
un complexe d’infériorité dont ils auront longtemps à souffrir.
|
Pour
faire suite à ce déchirant témoignage qui, encore une
fois, doit sensibiliser tous les anciens de Domois et
peut-être d’autres personnes qui liront ces lignes,
je vais continuer de parler et rendre hommage à tous
ces personnes qui ont vu défiler nos jeunes années.
|
 Souvenons-nous de cet homme, que nous appelions tous :
M. Pichot (frère Émile). Il semblait avoir été placé
là par la Providence - à voir ses qualités humaines - pour
combler une place laissée vide dans le cœur de tous ces jeunes
garçons : place occupée jadis par une affection paternelle,
aujourd’hui disparue.
Souvenons-nous de cet homme, que nous appelions tous :
M. Pichot (frère Émile). Il semblait avoir été placé
là par la Providence - à voir ses qualités humaines - pour
combler une place laissée vide dans le cœur de tous ces jeunes
garçons : place occupée jadis par une affection paternelle,
aujourd’hui disparue.
Frère
EMILE et son groupe

|
 Il était la bonté, cet homme, plus, il avait un cœur de
père, une tendresse de mère, pour les moutards déshérités
que nous étions (en tout bien, tout honneur).
Il était la bonté, cet homme, plus, il avait un cœur de
père, une tendresse de mère, pour les moutards déshérités
que nous étions (en tout bien, tout honneur).
 Que demande un gosse qui n’a plus de père, plus de mère
? Du pain, un toit, des vêtements ? Oui sans doute, mais par-dessus
tout, ce qu’il veut, ce qu’il mendie, ce qu’il supplie qu’on
lui donne ? c’est de l’affection, de la tendresse.
Que demande un gosse qui n’a plus de père, plus de mère
? Du pain, un toit, des vêtements ? Oui sans doute, mais par-dessus
tout, ce qu’il veut, ce qu’il mendie, ce qu’il supplie qu’on
lui donne ? c’est de l’affection, de la tendresse.
 Et le frère Emile était de ceux qui la leur prodiguait.
Je le vois toujours, ce brave homme, vêtu de bleu - il était
à l’époque le chef incontesté de la menuiserie, son domaine
- son inséparable casquette bien posée, légèrement sur le
devant, ses moustaches épaisses, et qui piquaient les joues,
quand il nous embrassait ; en mains, son paquet de tabac pour
en rouler “une de gris” de temps en temps, et le briquet qu’il
nous tendait pour que nous ayons la joie “d’allumer” : tel
apparaissait frère Emile, la première fois qu’on l’approchait.
Et le frère Emile était de ceux qui la leur prodiguait.
Je le vois toujours, ce brave homme, vêtu de bleu - il était
à l’époque le chef incontesté de la menuiserie, son domaine
- son inséparable casquette bien posée, légèrement sur le
devant, ses moustaches épaisses, et qui piquaient les joues,
quand il nous embrassait ; en mains, son paquet de tabac pour
en rouler “une de gris” de temps en temps, et le briquet qu’il
nous tendait pour que nous ayons la joie “d’allumer” : tel
apparaissait frère Emile, la première fois qu’on l’approchait.
 Les dimanches et jours de fête, peu de changement, il
troquait son bleu de travail contre un costume de gros drap,
une casquette plus propre, presque neuve mais sœur jumelle
de celle des jours ordinaires. Enfin ses espadrilles de corde
étaient de repos et il chaussait une paire de brodequins jaunes
à tige montante : c’était frère Emile endimanché.
Les dimanches et jours de fête, peu de changement, il
troquait son bleu de travail contre un costume de gros drap,
une casquette plus propre, presque neuve mais sœur jumelle
de celle des jours ordinaires. Enfin ses espadrilles de corde
étaient de repos et il chaussait une paire de brodequins jaunes
à tige montante : c’était frère Emile endimanché.
 C’était chaque jour qu’il venait “se rajeunir” au milieu
de ses “gamins” (c’était son mot). Après le repas de midi,
et le dimanche avant la grand-messe, il apparaissait invariablement
à la petite porte reliant le Saint-François-Xavier des étudiants
avec la cour de l’orphelinat. Nous la connaissions bien cette
porte, et à l’heure dite, nous observions les mouvements,
espérant voir apparaître la casquette de frère Emile. Dès
qu’il apparaissait, nous volions à sa rencontre, et c’était
à qui serait le premier dans ses bras, pour l’embrasser “fort”
quand il était bien rasé, et “tout doucement” quand ça piquait.
Et chacun de lui raconter ses petits problèmes qui d’ordinaire
ne passionnent pas les grandes personnes - peut-être aussi
nos histoires ne l’intéressaient pas - mais il faisait, et
c’est là qu’était sa bonté, comme si elles le passionnaient
au plus haut point. En faut-il davantage à un gosse pour se
sentir aimé ?
C’était chaque jour qu’il venait “se rajeunir” au milieu
de ses “gamins” (c’était son mot). Après le repas de midi,
et le dimanche avant la grand-messe, il apparaissait invariablement
à la petite porte reliant le Saint-François-Xavier des étudiants
avec la cour de l’orphelinat. Nous la connaissions bien cette
porte, et à l’heure dite, nous observions les mouvements,
espérant voir apparaître la casquette de frère Emile. Dès
qu’il apparaissait, nous volions à sa rencontre, et c’était
à qui serait le premier dans ses bras, pour l’embrasser “fort”
quand il était bien rasé, et “tout doucement” quand ça piquait.
Et chacun de lui raconter ses petits problèmes qui d’ordinaire
ne passionnent pas les grandes personnes - peut-être aussi
nos histoires ne l’intéressaient pas - mais il faisait, et
c’est là qu’était sa bonté, comme si elles le passionnaient
au plus haut point. En faut-il davantage à un gosse pour se
sentir aimé ?
 Au fait, je me trompe peut-être, car lorsqu’on aime, les
choses les plus insignifiantes ont grande valeur ; pour lui
elles en avaient une : nous faire sentir qu’il nous aimait.
Au fait, je me trompe peut-être, car lorsqu’on aime, les
choses les plus insignifiantes ont grande valeur ; pour lui
elles en avaient une : nous faire sentir qu’il nous aimait.
 Il savait bien que nous n’avions pas faim, frère Emile,
mais il savait aussi que les petites douceurs n’étaient pas
coutume... à l’époque. Les poches de son bleu, comme celles
de sa veste du dimanche, en étaient toujours largement pourvues.
C’était connu de tous : son dessert passait dans ses poches,
c’était pour ses gamins. Une pomme, une mandarine, quelques
petits biscuits, voire même quand c’était l’époque, un saint
Nicolas en pain d’épice, ou de petits œufs de Pâques ; ce
n’est pas grand-chose... quand on en a, mais quand on en est
privé!.. et que c’est de si gentil cœur, alors si, c’est quelque
chose.
Il savait bien que nous n’avions pas faim, frère Emile,
mais il savait aussi que les petites douceurs n’étaient pas
coutume... à l’époque. Les poches de son bleu, comme celles
de sa veste du dimanche, en étaient toujours largement pourvues.
C’était connu de tous : son dessert passait dans ses poches,
c’était pour ses gamins. Une pomme, une mandarine, quelques
petits biscuits, voire même quand c’était l’époque, un saint
Nicolas en pain d’épice, ou de petits œufs de Pâques ; ce
n’est pas grand-chose... quand on en a, mais quand on en est
privé!.. et que c’est de si gentil cœur, alors si, c’est quelque
chose.
 Combien de ceux qui liront ces lignes ont connu et apprécié
frère Emile, soit à la menuiserie où il avait en permanence
un ou deux apprentis, soit au jardin ou dans les champs. Il
était originaire de la Meuse, il avait en 1913 quitté sa maison,
son atelier et suivi le Conseil de l’Evangile pour s’exiler
en Belgique et devenir religieux chez les prêtres du Sacré-Cœur.
Trois mois après son engagement religieux, c’est la guerre,
la mobilisation, la vie au front pendant quatre ans.
Combien de ceux qui liront ces lignes ont connu et apprécié
frère Emile, soit à la menuiserie où il avait en permanence
un ou deux apprentis, soit au jardin ou dans les champs. Il
était originaire de la Meuse, il avait en 1913 quitté sa maison,
son atelier et suivi le Conseil de l’Evangile pour s’exiler
en Belgique et devenir religieux chez les prêtres du Sacré-Cœur.
Trois mois après son engagement religieux, c’est la guerre,
la mobilisation, la vie au front pendant quatre ans.
 Il rejoint la maison du Sacré-Coeur à Saint-Quentin, en
partie démolie par les hostilités, où l’on réclamait un frère
compétent pour se charger de la reconstruction.
Il rejoint la maison du Sacré-Coeur à Saint-Quentin, en
partie démolie par les hostilités, où l’on réclamait un frère
compétent pour se charger de la reconstruction.
 Quand les prêtres du Sacré-Cœur viennent à Domois assurer
la relève, le frère Emile quitte l’Aisne pour la Côte-d’Or
(il devait y rester jusqu’à sa mort, 36 ans plus tard).
Quand les prêtres du Sacré-Cœur viennent à Domois assurer
la relève, le frère Emile quitte l’Aisne pour la Côte-d’Or
(il devait y rester jusqu’à sa mort, 36 ans plus tard).
 C’est alors qu’il prend la direction de la menuiserie.
Il suffit d’examiner les bancs de la chapelle, les meubles
de la sacristie pour constater que ce bon frère savait à l’occasion
se hausser à la véritable ébénisterie. Le bois, il l’aimait,
l’économisait, le travaillait avec passion, savait du moindre
bout de chevron tirer le maximum. Les diverses essences n’avaient
pour lui pas de mystère. Jamais aussi il n’était plus heureux
que lorsqu’il pouvait planter, tailler, greffer : le bois
vivant l’intéressant autant que l’autre.
C’est alors qu’il prend la direction de la menuiserie.
Il suffit d’examiner les bancs de la chapelle, les meubles
de la sacristie pour constater que ce bon frère savait à l’occasion
se hausser à la véritable ébénisterie. Le bois, il l’aimait,
l’économisait, le travaillait avec passion, savait du moindre
bout de chevron tirer le maximum. Les diverses essences n’avaient
pour lui pas de mystère. Jamais aussi il n’était plus heureux
que lorsqu’il pouvait planter, tailler, greffer : le bois
vivant l’intéressant autant que l’autre.
 Impossible de le “coller” dans ce domaine où il se perfectionnait
sans cesse. Non seulement la plupart des meubles de l’orphelinat
sont passés par ses mains, mais quasi tous les arbres de la
propriété lui doivent la vie ou furent examinés, émondés,
greffés par cet ami passionné de la nature et des fleurs aussi.
Impossible de le “coller” dans ce domaine où il se perfectionnait
sans cesse. Non seulement la plupart des meubles de l’orphelinat
sont passés par ses mains, mais quasi tous les arbres de la
propriété lui doivent la vie ou furent examinés, émondés,
greffés par cet ami passionné de la nature et des fleurs aussi.
 Travailleur infatigable, il était encore à l’ouvrage à
77 ans ! Et quand ses forces trahirent sa volonté, sa tâche
fut désormais d’édifier sa communauté par une vie religieuse
exemplaire et de prier. Le premier à la chapelle le matin,
qu’il visitait même dans ses heures d’insomnie, il était pour
tous ceux qui l’approchaient un modèle de ponctualité et de
modestie.
Travailleur infatigable, il était encore à l’ouvrage à
77 ans ! Et quand ses forces trahirent sa volonté, sa tâche
fut désormais d’édifier sa communauté par une vie religieuse
exemplaire et de prier. Le premier à la chapelle le matin,
qu’il visitait même dans ses heures d’insomnie, il était pour
tous ceux qui l’approchaient un modèle de ponctualité et de
modestie.
 Frère Emile est décédé à l’âge de 80 ans, sans souffrances,
sans agonie, après une vie religieuse passée presque entièrement
au service des orphelins.
Frère Emile est décédé à l’âge de 80 ans, sans souffrances,
sans agonie, après une vie religieuse passée presque entièrement
au service des orphelins.
|
Voilà
encore l’histoire bien raccourcie d’un homme de bonté,
qui mérite de tous les orphelins une éternelle reconnaissance.
|
 Et notre ami Lucien Threis, vous vous rappelez,
l’homme au béret et son cheval ! Je ne puis l’oublier, car
lui aussi s’est donné sans compter pour Domois, il y resta
42 ans.
Et notre ami Lucien Threis, vous vous rappelez,
l’homme au béret et son cheval ! Je ne puis l’oublier, car
lui aussi s’est donné sans compter pour Domois, il y resta
42 ans.
Lucien
THREIS
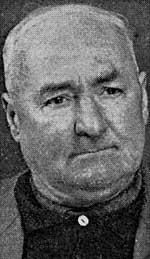
|
 C’était une figure pittoresque de la maison de Domois,
on l’appelait d’ailleurs “Monsieur Lucien”.
C’était une figure pittoresque de la maison de Domois,
on l’appelait d’ailleurs “Monsieur Lucien”.
 Homme à tout faire, doué d’une force peu ordinaire, on
le vit aussi faire le terrassier, le bûcheron diriger l’exploitation
agricole du domaine pendant la guerre en l’absence du chef
de ferme appelé sous les drapeaux.
Homme à tout faire, doué d’une force peu ordinaire, on
le vit aussi faire le terrassier, le bûcheron diriger l’exploitation
agricole du domaine pendant la guerre en l’absence du chef
de ferme appelé sous les drapeaux.
 Le verbe haut et parlant la langue de l’occupant, il défendait
pied à pied les intérêts de l’orphelinat. On l’utilisait même
comme fossoyeur pour préparer la dernière demeure des pères,
sœurs et des orphelins parfois.
Le verbe haut et parlant la langue de l’occupant, il défendait
pied à pied les intérêts de l’orphelinat. On l’utilisait même
comme fossoyeur pour préparer la dernière demeure des pères,
sœurs et des orphelins parfois.
 Mais sa tâche la plus courante était dans les années 1955-1960
celle de chauffeur-livreur, passant en quelques décades de
la voiture à cheval à la 403 Peugeot ; nombre de fournisseurs,
d’employés des Postes et de la gare, de clients de l’imprimerie
se souviennent du personnage.
Mais sa tâche la plus courante était dans les années 1955-1960
celle de chauffeur-livreur, passant en quelques décades de
la voiture à cheval à la 403 Peugeot ; nombre de fournisseurs,
d’employés des Postes et de la gare, de clients de l’imprimerie
se souviennent du personnage.
 Pour avoir sillonné la ville un nombre incalculable de
fois, il était imbattable quand il fallait retrouver le nom,
l’emplacement et l’aboutissement d’une rue dijonnaise.
Pour avoir sillonné la ville un nombre incalculable de
fois, il était imbattable quand il fallait retrouver le nom,
l’emplacement et l’aboutissement d’une rue dijonnaise.
 Les anciens basketteurs, petits et grands se souviennent
des déplacements qu’ils ont fait dans la camionnette bâchée
en sa bonne compagnie. Il n’a, même lorsque les jeunes champions
gagnaient, jamais eu le moindre accident de la route.
Les anciens basketteurs, petits et grands se souviennent
des déplacements qu’ils ont fait dans la camionnette bâchée
en sa bonne compagnie. Il n’a, même lorsque les jeunes champions
gagnaient, jamais eu le moindre accident de la route.
 Pourtant il fêtait doublement les succès acquis dans toute
la Bourgogne. Il aimait beaucoup ces orphelins qu’il transportait
au début du siècle dans son premier véhicule hippomobile,
c’était moins dangereux.
Pourtant il fêtait doublement les succès acquis dans toute
la Bourgogne. Il aimait beaucoup ces orphelins qu’il transportait
au début du siècle dans son premier véhicule hippomobile,
c’était moins dangereux.
 Le chanoine Kir lui-même lui remit la médaille des vieux
travailleurs, qui récompensait trente-cinq années d’activité
généreuse et désintéressée à Domois. Il remercia par ces mots
ce geste qui l’honorait au plus au point :
Le chanoine Kir lui-même lui remit la médaille des vieux
travailleurs, qui récompensait trente-cinq années d’activité
généreuse et désintéressée à Domois. Il remercia par ces mots
ce geste qui l’honorait au plus au point :
 “Monsieur le député-maire, malgré vos nombreuses obligations
nationales et régionales, vous avez accepté de venir en personne
me remettre cette belle médaille. De tout cœur je vous en
remercie.
“Monsieur le député-maire, malgré vos nombreuses obligations
nationales et régionales, vous avez accepté de venir en personne
me remettre cette belle médaille. De tout cœur je vous en
remercie.
 Un grand merci à M. Avignant qui représente les Anciens.
Dieu sait si j’en connais ! A travers vous, père directeur
(c’était le père Le Berre), je m’adresse à toute la Maison
de Domois. Je tiens à vous dire combien je suis heureux de
travailler dans notre chère maison et “puisque les voyages
forment la jeunesse” j’espère pouvoir m’y dépenser de longues
années encore. Cette fête est aussi celle de tous ceux qui
travaillent avec moi ici. Ils le méritent autant que moi.
Un grand merci à M. Avignant qui représente les Anciens.
Dieu sait si j’en connais ! A travers vous, père directeur
(c’était le père Le Berre), je m’adresse à toute la Maison
de Domois. Je tiens à vous dire combien je suis heureux de
travailler dans notre chère maison et “puisque les voyages
forment la jeunesse” j’espère pouvoir m’y dépenser de longues
années encore. Cette fête est aussi celle de tous ceux qui
travaillent avec moi ici. Ils le méritent autant que moi.
 Mes chers enfants, vous le savez, je ne suis ni docteur,
ni ingénieur. Je suis un simple conducteur. Je tâche tout
simplement de bien faire le travail que l’on me confie.
Mes chers enfants, vous le savez, je ne suis ni docteur,
ni ingénieur. Je suis un simple conducteur. Je tâche tout
simplement de bien faire le travail que l’on me confie.
 Vous aussi plus tard, soyez de fidèles travailleurs partout
où vous serez. Et pour terminer, je vous dis avec La Fontaine,
bien que je ne sente pas venir ma fin prochaine : “Travaillez,
prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins !”
Vous aussi plus tard, soyez de fidèles travailleurs partout
où vous serez. Et pour terminer, je vous dis avec La Fontaine,
bien que je ne sente pas venir ma fin prochaine : “Travaillez,
prenez de la peine, c’est le fond qui manque le moins !”
|
On
voit dans ce personnage toute la modestie et le dévouement
qu’il avait envers les orphelins et sa Maison où il
se trouvait tellement bien...
|
 Il n’a jamais, aux dires du père Le Berre, réclamé son
salaire et ne prendra pas sa retraite et ses seules vacances
furent de participer au pèlerinage bourguignon à Lourdes où
avec une certaine fierté, il assurait les fonctions de porte-drapeau.
Il n’a jamais, aux dires du père Le Berre, réclamé son
salaire et ne prendra pas sa retraite et ses seules vacances
furent de participer au pèlerinage bourguignon à Lourdes où
avec une certaine fierté, il assurait les fonctions de porte-drapeau.
 Sa santé commença à décliner mais jusqu’au bout il refusa
de s’avouer vaincu et trouva encore à s’employer à de petits
travaux domestiques ou au bûcher. M. Lucien s’en est allé
un peu comme il est venu, sans bruit, après plus de quarante
années passées à Domois en serviteur dévoué. Notre-Dame de
Domois aura certainement bien accueilli cet homme qui ne venait
pas de la religion, mais qui était tellement bon et généreux.
Sa santé commença à décliner mais jusqu’au bout il refusa
de s’avouer vaincu et trouva encore à s’employer à de petits
travaux domestiques ou au bûcher. M. Lucien s’en est allé
un peu comme il est venu, sans bruit, après plus de quarante
années passées à Domois en serviteur dévoué. Notre-Dame de
Domois aura certainement bien accueilli cet homme qui ne venait
pas de la religion, mais qui était tellement bon et généreux.
 Les pères du Sacré-Cœur, comme nous l’avons vu plus haut,
avaient bien du travail pour remettre en état cet établissement
et ils désiraient aussi mettre en œuvre leur projet d’éducation.
Il ont commencé par appliquer ce qu’ils avaient appris et
fait dans leur jeunesse et dans des établissements différents
où ils étaient passés.
Les pères du Sacré-Cœur, comme nous l’avons vu plus haut,
avaient bien du travail pour remettre en état cet établissement
et ils désiraient aussi mettre en œuvre leur projet d’éducation.
Il ont commencé par appliquer ce qu’ils avaient appris et
fait dans leur jeunesse et dans des établissements différents
où ils étaient passés.
 Les jeunes pères et frères du Sacré-Cœur savaient occuper
les orphelins dans les années 1935-1937. Parfois certaines
activités n’étaient pas tristes...
Les jeunes pères et frères du Sacré-Cœur savaient occuper
les orphelins dans les années 1935-1937. Parfois certaines
activités n’étaient pas tristes...
 L’un des pères avait pris l’initiative de mettre en place
une troupe de scouts qui avait fière allure et aussi grande
réputation. Lors d’un concours de district, à Gevrey, nos
patrouilles s’étant particulièrement distinguées, un des chefs
présents, le commissaire, je crois, disait “de la 1re Domois
rien ne saurait nous surprendre”. C’était bien sûr un compliment,
car nous donnions tout ce que nous avions dans le “ventre”
pour montrer aux autres que nous les orphelins nous pouvions
être aussi bons qu’eux. Et notre groupe théâtre a aussi meublé
nos loisirs, grâce à la compétence du père Roblot, qui avait
bien de la patience avec nous ; il faut avouer que nous ne
savions quoi inventer pour lui rendre la tâche difficile.
Le moment venu nous savions bien sûr nos textes et nos tirades,
nous faisions un “triomphe” !
L’un des pères avait pris l’initiative de mettre en place
une troupe de scouts qui avait fière allure et aussi grande
réputation. Lors d’un concours de district, à Gevrey, nos
patrouilles s’étant particulièrement distinguées, un des chefs
présents, le commissaire, je crois, disait “de la 1re Domois
rien ne saurait nous surprendre”. C’était bien sûr un compliment,
car nous donnions tout ce que nous avions dans le “ventre”
pour montrer aux autres que nous les orphelins nous pouvions
être aussi bons qu’eux. Et notre groupe théâtre a aussi meublé
nos loisirs, grâce à la compétence du père Roblot, qui avait
bien de la patience avec nous ; il faut avouer que nous ne
savions quoi inventer pour lui rendre la tâche difficile.
Le moment venu nous savions bien sûr nos textes et nos tirades,
nous faisions un “triomphe” !
La
troupe des Scouts

|
 Le cinéma fait son apparition. Voici une anecdote qui
montre comment cela se passait et mérite d’être racontée.
Le cinéma fait son apparition. Voici une anecdote qui
montre comment cela se passait et mérite d’être racontée.
 La voiture du projectionniste arrive un dimanche au beau
milieu d’un petit monde déjà tout en effervescence.
La voiture du projectionniste arrive un dimanche au beau
milieu d’un petit monde déjà tout en effervescence.
- Chouette,
y a du ciné ! On va rigoler ! Un film de Chaplin, dit Charlot,
grande vedette de l’ancien temps, était au programme.
 Voici que débouche le père Paul, il traverse la cour en
coup de vent, selon son habitude ; calotte ronde sur la tête,
l’œil allumé derrière ses lunettes qui lui font de gros yeux,
une chaîne qui pend de l’une de ses poches de soutane, avec
son inséparable trousseau de clés, et le non moins légendaire
sifflet à roulette : agent indispensable de l’ordre et de
la discipline. Au bout de chaque bras, une caissette qui parait
peser son poids : c’est l’opérateur qui arrive avec armes
et bagages. Il s’engouffre dans la salle de spectacle, “grande
salle” comme on disait à l’époque. Ici, pas de cabine d’opérateur
avec ses deux yeux carrés. Non, une table qui tient bien d’aplomb...
avec une cale en dessous.
Voici que débouche le père Paul, il traverse la cour en
coup de vent, selon son habitude ; calotte ronde sur la tête,
l’œil allumé derrière ses lunettes qui lui font de gros yeux,
une chaîne qui pend de l’une de ses poches de soutane, avec
son inséparable trousseau de clés, et le non moins légendaire
sifflet à roulette : agent indispensable de l’ordre et de
la discipline. Au bout de chaque bras, une caissette qui parait
peser son poids : c’est l’opérateur qui arrive avec armes
et bagages. Il s’engouffre dans la salle de spectacle, “grande
salle” comme on disait à l’époque. Ici, pas de cabine d’opérateur
avec ses deux yeux carrés. Non, une table qui tient bien d’aplomb...
avec une cale en dessous.
 Pas d’embobineuse électrique, mais une bonne manivelle
et puis... des pinces, du fil, de la colle, des ciseaux, des
bobines de fil électrique pour baladeuses, etc., etc., le
tout pêle-mêle à proximité de l’appareil à manivelle.
Pas d’embobineuse électrique, mais une bonne manivelle
et puis... des pinces, du fil, de la colle, des ciseaux, des
bobines de fil électrique pour baladeuses, etc., etc., le
tout pêle-mêle à proximité de l’appareil à manivelle.
-
Bon, frère, vous pouvez faire rentrer, c’est prêt !
 Pas besoin de faire la guerre au guichet pour prendre
un billet, l’entrée est gratuite. On est même prêt à vous
rembourser si vous n’êtes pas satisfait, comme dans les grands
établissements. Mais allez donc faire rentrer calmement une
telle bande : ça se bouscule, tout juste si l’appareil ne
va pas faire connaissance avec la dalle de ciment.
Pas besoin de faire la guerre au guichet pour prendre
un billet, l’entrée est gratuite. On est même prêt à vous
rembourser si vous n’êtes pas satisfait, comme dans les grands
établissements. Mais allez donc faire rentrer calmement une
telle bande : ça se bouscule, tout juste si l’appareil ne
va pas faire connaissance avec la dalle de ciment.
-
Bon, tout le monde est en place. Lumière !
 Ca s’éteint ! Un moment de silence, une petite lampe s’allume,
l’écran devient lumineux. Bon ça démarre, quelques coups de
manivelle, un petit bruit qui signifie : tout va bien, on
peut y aller, et un titre apparaît : clair, lumineux, un peu
de travers, et qui danse la carmagnole avant d’avoir trouvé
sa place définitive :
Ca s’éteint ! Un moment de silence, une petite lampe s’allume,
l’écran devient lumineux. Bon ça démarre, quelques coups de
manivelle, un petit bruit qui signifie : tout va bien, on
peut y aller, et un titre apparaît : clair, lumineux, un peu
de travers, et qui danse la carmagnole avant d’avoir trouvé
sa place définitive :
“Charlot
dans ses nouvelles aventures”
 Un “ah” admiratif et approbateur salue notre vedette,
et le film commence. Rires étouffés, rires aux éclats, commentaires
en sourdine ou à haute voix, tout y est. Cela durait bien
depuis un bon moment, les nerfs étaient détendus, l’atmosphère
plus calme... quand tout à coup, un bruit étrange, bruit de
moteur exhalant son dernier soupir. Lumière !
Un “ah” admiratif et approbateur salue notre vedette,
et le film commence. Rires étouffés, rires aux éclats, commentaires
en sourdine ou à haute voix, tout y est. Cela durait bien
depuis un bon moment, les nerfs étaient détendus, l’atmosphère
plus calme... quand tout à coup, un bruit étrange, bruit de
moteur exhalant son dernier soupir. Lumière !
 Tout était prévu, un petit gars, ces jours-là, devenu
spécialiste se tenait en permanence auprès du commutateur
pour les besoins de la cause, et cette cause était fréquente
: la panne. Un “oh” désapprobateur, presque angoissé, s’échappe
avec un ensemble charmant. Chacun essaie de voir, de comprendre,
se lève, se rassied, se relève pour supputer les chances de
succès... ou d’insuccès.
Tout était prévu, un petit gars, ces jours-là, devenu
spécialiste se tenait en permanence auprès du commutateur
pour les besoins de la cause, et cette cause était fréquente
: la panne. Un “oh” désapprobateur, presque angoissé, s’échappe
avec un ensemble charmant. Chacun essaie de voir, de comprendre,
se lève, se rassied, se relève pour supputer les chances de
succès... ou d’insuccès.
 Mais le père Paul est là : aussitôt armé du ciseau, de
la colle, il coupe, il assemble, il recolle ; la calotte en
bataille, l’œil inquisiteur, la main habile ; la chance tourne
de notre côté et Charlot va nous revenir. Quelques coups de
manivelle. Lumière ! Ça redémarre ! “Ah” comme d’habitude.
Eclats de rires, les commentaires reprennent. Charlie se décarcasse,
fait des acrobaties, “fauche” des semelles, moulinette du
pépin, s’assoit sur une poêle brûlante. Et voilà qu’en pleine
action “crac” ! Lumière ! Cette fois-ci c’est plus sérieux,
le “oh” est resté dans les gorges, et l’on envisage la reprise
du film un autre jour. Désastre !
Mais le père Paul est là : aussitôt armé du ciseau, de
la colle, il coupe, il assemble, il recolle ; la calotte en
bataille, l’œil inquisiteur, la main habile ; la chance tourne
de notre côté et Charlot va nous revenir. Quelques coups de
manivelle. Lumière ! Ça redémarre ! “Ah” comme d’habitude.
Eclats de rires, les commentaires reprennent. Charlie se décarcasse,
fait des acrobaties, “fauche” des semelles, moulinette du
pépin, s’assoit sur une poêle brûlante. Et voilà qu’en pleine
action “crac” ! Lumière ! Cette fois-ci c’est plus sérieux,
le “oh” est resté dans les gorges, et l’on envisage la reprise
du film un autre jour. Désastre !
 Ah, je vois, vous ne connaissez pas notre cinéaste ! Dix
minutes d’entracte. Et le père Paul fouille, déplace, replace,
pose des questions, s’énerve.
Ah, je vois, vous ne connaissez pas notre cinéaste ! Dix
minutes d’entracte. Et le père Paul fouille, déplace, replace,
pose des questions, s’énerve.
- Mais
où est cette boîte ? Je l’avais mise là ! Peine perdue ;
on la cherchait à droite... elle était à gauche, dans la
caissette à bobines, avec la colle et les ciseaux.
 Un “ah” de soulagement et de la petite coquine sort une
belle ampoule toute neuve pour remplacer sa soeur morte dans
l’exercice de ses fonctions. Il avait tout prévu, le technicien
de la maison. On est sauvé ! Chacun reprend sa place. Lumière
! Le commutateur s’abaisse, nous laissant quelques instants
dans l’obscurité... redoutable.
Un “ah” de soulagement et de la petite coquine sort une
belle ampoule toute neuve pour remplacer sa soeur morte dans
l’exercice de ses fonctions. Il avait tout prévu, le technicien
de la maison. On est sauvé ! Chacun reprend sa place. Lumière
! Le commutateur s’abaisse, nous laissant quelques instants
dans l’obscurité... redoutable.
 On repart oui... mais... la bobine est à l’envers : cela
ne dérangeait nullement notre Charlot, habitué à ces excentricités
! Lumière ! Le Père Paul s’éponge, marmonne un peu entre ses
dents, s’adressant sans doute à sainte Rita, la patronne des
causes désespérées, en une prière qu’il aurait souhaitée plus
intime. Bon, voilà Charlot sur ses pieds... Lumière... Et
pour la troisième fois, la séance recommence. Et plus Charlot
se démène, fait de singeries, plus l’assistance vibre, se
trémousse, jubile, rit et pouffe.
On repart oui... mais... la bobine est à l’envers : cela
ne dérangeait nullement notre Charlot, habitué à ces excentricités
! Lumière ! Le Père Paul s’éponge, marmonne un peu entre ses
dents, s’adressant sans doute à sainte Rita, la patronne des
causes désespérées, en une prière qu’il aurait souhaitée plus
intime. Bon, voilà Charlot sur ses pieds... Lumière... Et
pour la troisième fois, la séance recommence. Et plus Charlot
se démène, fait de singeries, plus l’assistance vibre, se
trémousse, jubile, rit et pouffe.
 Vous me croirez si vous voulez, eh bien, on est arrivé
à passer toutes les bobines, et il restait encore du fil,
de la colle, et tout l’attirail pour... la prochaine séance.
Vous me croirez si vous voulez, eh bien, on est arrivé
à passer toutes les bobines, et il restait encore du fil,
de la colle, et tout l’attirail pour... la prochaine séance.
 Le narrateur de cette fameuse séance de cinéma, ne dit
pas à quelle heure cela s’est terminé.
Le narrateur de cette fameuse séance de cinéma, ne dit
pas à quelle heure cela s’est terminé.
 Chacun se souvient, surtout dans la section des petits,
des séances de projection de “Tintin et Milou”. Là aussi nous
en avons eu des sueurs froides, car la lampe du projecteur
lâchait souvent et le père Humbert (“dix heures dix”), ne
prenait pas la précaution d’en avoir une de rechange...
Chacun se souvient, surtout dans la section des petits,
des séances de projection de “Tintin et Milou”. Là aussi nous
en avons eu des sueurs froides, car la lampe du projecteur
lâchait souvent et le père Humbert (“dix heures dix”), ne
prenait pas la précaution d’en avoir une de rechange...
 Nous devions attendre le prochain jeudi pour connaître
la suite des aventures de notre idole.
Nous devions attendre le prochain jeudi pour connaître
la suite des aventures de notre idole.
 Mais nous étions si heureux de pouvoir avoir de si belles
récompenses, car bien sûr il fallait mériter de tels avantages.
Mais nous étions si heureux de pouvoir avoir de si belles
récompenses, car bien sûr il fallait mériter de tels avantages.
 A Domois, les pères du Sacré-Cœur faisaient le maximum
pour que les orphelins puissent s’épanouir dans le “meilleur
des mondes”. Les orphelins travaillaient sans doute, mais
ils apprenaient aussi, pour certains leur futur métier. Et
leur premier maître fut un de leur ancien compagnon.
A Domois, les pères du Sacré-Cœur faisaient le maximum
pour que les orphelins puissent s’épanouir dans le “meilleur
des mondes”. Les orphelins travaillaient sans doute, mais
ils apprenaient aussi, pour certains leur futur métier. Et
leur premier maître fut un de leur ancien compagnon.
Le
groupe avec 3 soeurs

|
 D ’après Robert Cousin, un de ses anciens apprentis des années
1945-1950, M. Morisot était de petite taille, toujours
sa casquette sur la tête, peut-être pour cacher une calvitie
déjà bien avancée et les quelques cheveux gris-blancs qui
lui restaient. Au coin des lèvres, un mégot de cigarette souvent
éventré, toujours éteint. Il les roulait lui-même, aussi fallait-il
qu’il les recollent et les rallument souvent, penchant la
tête sur le côté pour ne pas brûler la visière de sa casquette,
avec un briquet dont la longue flamme avait tout d’un chalumeau
(les briquets de ce temps-là marchaient à l’essence).
D ’après Robert Cousin, un de ses anciens apprentis des années
1945-1950, M. Morisot était de petite taille, toujours
sa casquette sur la tête, peut-être pour cacher une calvitie
déjà bien avancée et les quelques cheveux gris-blancs qui
lui restaient. Au coin des lèvres, un mégot de cigarette souvent
éventré, toujours éteint. Il les roulait lui-même, aussi fallait-il
qu’il les recollent et les rallument souvent, penchant la
tête sur le côté pour ne pas brûler la visière de sa casquette,
avec un briquet dont la longue flamme avait tout d’un chalumeau
(les briquets de ce temps-là marchaient à l’essence).
M.
MORISOT

|
 Je le revois encore trottinant avec ses grosses charentaises,
aller de son petit bureau, faire le plein de son briquet à
la bouteille d’essence qui trônait sur le marbre. Il était
discret, bienveillant, presque paternel. Il fallait faire
une grosse bêtise pour le voir fâché. Quand, en composant,
nous lui demandions l’orthographe d’un mot ou l’accord d’un
verbe, il nous récitait par cœur tout le paragraphe le concernant.
Il connaissait sa grammaire et toutes les règles typographiques
“sur le bout des doigts”.
Je le revois encore trottinant avec ses grosses charentaises,
aller de son petit bureau, faire le plein de son briquet à
la bouteille d’essence qui trônait sur le marbre. Il était
discret, bienveillant, presque paternel. Il fallait faire
une grosse bêtise pour le voir fâché. Quand, en composant,
nous lui demandions l’orthographe d’un mot ou l’accord d’un
verbe, il nous récitait par cœur tout le paragraphe le concernant.
Il connaissait sa grammaire et toutes les règles typographiques
“sur le bout des doigts”.
 Eugène Morisot fut un des premiers orphelins du père Chanlon
et il a été également un des premiers apprentis. Après son
départ de l’orphelinat à ses 18 ans, il part faire son petit
tour de France, sur le “trimard” ou le compagnonnage, comme
on disait à cette époque. Puis, après quelques mois, trouvant
son bagage de connaissances suffisant, il rentre à nouveau
à Domois, mais cette fois pour y prendre la direction de l’imprimerie,
qu’il assurera jusqu’en 1949. C’était un homme laborieux et
sa tâche n’a pas toujours été facile, avec les apprentis qu’il
était chargé de former, jamais cependant il n’a connu de découragement.
Eugène Morisot fut un des premiers orphelins du père Chanlon
et il a été également un des premiers apprentis. Après son
départ de l’orphelinat à ses 18 ans, il part faire son petit
tour de France, sur le “trimard” ou le compagnonnage, comme
on disait à cette époque. Puis, après quelques mois, trouvant
son bagage de connaissances suffisant, il rentre à nouveau
à Domois, mais cette fois pour y prendre la direction de l’imprimerie,
qu’il assurera jusqu’en 1949. C’était un homme laborieux et
sa tâche n’a pas toujours été facile, avec les apprentis qu’il
était chargé de former, jamais cependant il n’a connu de découragement.
 Ce travail, il l’a toujours accompli avec un grand dévouement,
donnant à chacun les conseils nécessaires pour apprendre d’une
façon parfaite un métier, difficile certes, mais plein d’avenir.
Cette tâche était parfois très rude, il faut le reconnaître,
nous qui avons profité de ses leçons et de ses grandes connaissances
du métier d’imprimeur. Modeste, il l’a été toute sa vie, ne
recherchant jamais la gloire ni les honneurs. Son mérite en
était d’autant plus grand.
Ce travail, il l’a toujours accompli avec un grand dévouement,
donnant à chacun les conseils nécessaires pour apprendre d’une
façon parfaite un métier, difficile certes, mais plein d’avenir.
Cette tâche était parfois très rude, il faut le reconnaître,
nous qui avons profité de ses leçons et de ses grandes connaissances
du métier d’imprimeur. Modeste, il l’a été toute sa vie, ne
recherchant jamais la gloire ni les honneurs. Son mérite en
était d’autant plus grand.
L'imprimerie

|
 M. Morisot, est décédé à l’âge de 85 ans, il n’a jamais
quitté Domois, lui aussi fut un brave homme au service des
orphelins et de Domois. Lors de cette période, d’autres personnes
aussi humbles aidèrent la Maison et participèrent eux aussi
à la vie des orphelins. Je ne peux en parler avec autant de
détails que celles que j’ai citées ci-dessus, mais elles méritent
aussi de faire partie de ce récit :
M. Morisot, est décédé à l’âge de 85 ans, il n’a jamais
quitté Domois, lui aussi fut un brave homme au service des
orphelins et de Domois. Lors de cette période, d’autres personnes
aussi humbles aidèrent la Maison et participèrent eux aussi
à la vie des orphelins. Je ne peux en parler avec autant de
détails que celles que j’ai citées ci-dessus, mais elles méritent
aussi de faire partie de ce récit :
 Binoco et Zizi, deux hommes ayant été recueillis
très certainement depuis le début par le père Chanlon et gardés
ultérieurement par les pères du Sacré-Cœur. Zizi était sourd
et muet, il s’occupait principalement des w.-c. de la maison,
et il déambulait dans la cour et les allées avec son seau
qui semblait lui peser. Il n’hésitait pas à se mettre à genoux
pour gratter consciencieusement la cuvette en ciment avec
son couteau de poche.
Binoco et Zizi, deux hommes ayant été recueillis
très certainement depuis le début par le père Chanlon et gardés
ultérieurement par les pères du Sacré-Cœur. Zizi était sourd
et muet, il s’occupait principalement des w.-c. de la maison,
et il déambulait dans la cour et les allées avec son seau
qui semblait lui peser. Il n’hésitait pas à se mettre à genoux
pour gratter consciencieusement la cuvette en ciment avec
son couteau de poche.
 Binoco et Zizi aidaient à la ferme, au jardin et faisaient
les tâches les plus désagréables. Je me souviens que chaque
année ils vidaient la fosse des latrines qui se trouvaient
dans la cour des grands (actuellement terrain de basket) et
des petits (cour intérieure du château).
Binoco et Zizi aidaient à la ferme, au jardin et faisaient
les tâches les plus désagréables. Je me souviens que chaque
année ils vidaient la fosse des latrines qui se trouvaient
dans la cour des grands (actuellement terrain de basket) et
des petits (cour intérieure du château).
 Il fallait voir ces pauvres hommes dans ces fosses, les
pieds et les mains dans ces excréments et suffoquant parfois
de ces odeurs nauséabondes. Ils remontaient la marchandise
aux seaux et ceux-ci étaient vidés dans une tonne que Lucien
épandait dans le jardin ou les champs alentours. Ces pauvres
hommes étaient “persécutés” parfois par les enfants qui profitaient
de leur faiblesse d’esprit et en rigolaient. Ils ne s’en rendaient
sans doute pas compte mais il arrivait que les plaisanteries
allaient trop loin et cela pouvait dégénérer, heureusement
que les chenapans avaient de bonnes jambes...
Il fallait voir ces pauvres hommes dans ces fosses, les
pieds et les mains dans ces excréments et suffoquant parfois
de ces odeurs nauséabondes. Ils remontaient la marchandise
aux seaux et ceux-ci étaient vidés dans une tonne que Lucien
épandait dans le jardin ou les champs alentours. Ces pauvres
hommes étaient “persécutés” parfois par les enfants qui profitaient
de leur faiblesse d’esprit et en rigolaient. Ils ne s’en rendaient
sans doute pas compte mais il arrivait que les plaisanteries
allaient trop loin et cela pouvait dégénérer, heureusement
que les chenapans avaient de bonnes jambes...
 Nous leur devons notre reconnaissance même si ce qu’ils
ont fait n’était pas spectaculaire à nos yeux.
Nous leur devons notre reconnaissance même si ce qu’ils
ont fait n’était pas spectaculaire à nos yeux.
 J’aimerais aussi parler de Robert Commaret (dit Toutou),
on ne sait qui a pu lui donner ce surnom ? Il est arrivé un
jour à Domois en 1934 et n’en est plus reparti.
J’aimerais aussi parler de Robert Commaret (dit Toutou),
on ne sait qui a pu lui donner ce surnom ? Il est arrivé un
jour à Domois en 1934 et n’en est plus reparti.
Robert
COMMARET

|
 Il était employé à la couture, à la buanderie, la cuisine
et au ménage. Un homme très simple et se contentant de presque
rien, ne se plaignant jamais, il était heureux à Domois. Il
est décédé à l’âge de 79 ans en 1997.
Il était employé à la couture, à la buanderie, la cuisine
et au ménage. Un homme très simple et se contentant de presque
rien, ne se plaignant jamais, il était heureux à Domois. Il
est décédé à l’âge de 79 ans en 1997.
|
A
Domois la vie continue et les directeurs se succèdent
après avoir rempli leur mission, tant morale, éducative
et protectrice envers les orphelins.
|
 En 1934, un nouveau bâtiment plus moderne fut construit
par le père Beck, destiné dans un premier temps aux vocations
tardives des pères du Sacré-Cœur et qui, par la suite, après
la guerre de 1939-1945, accueillera les orphelins de la 4e
génération (en 1947). C’est lui qu’on voit de loin installé
sur la butte quand on parcourt la route de Seurre. L’architecture
de l’ensemble est simple, mais équilibrée. Des plates-bandes
courent le long des murs, des fleurs agrémentent la cour d’entrée.
La disposition intérieure dénote un grand sens pratique. Réfectoire
spacieux et net, sur lequel débouchent les cuisines dont les
installations modernisées sont remarquables. Salles de classe
très vastes et bien organisées. Salles de récréation où l’on
ne mettait pas souvent les pieds, quelquefois en hiver et
encore...
En 1934, un nouveau bâtiment plus moderne fut construit
par le père Beck, destiné dans un premier temps aux vocations
tardives des pères du Sacré-Cœur et qui, par la suite, après
la guerre de 1939-1945, accueillera les orphelins de la 4e
génération (en 1947). C’est lui qu’on voit de loin installé
sur la butte quand on parcourt la route de Seurre. L’architecture
de l’ensemble est simple, mais équilibrée. Des plates-bandes
courent le long des murs, des fleurs agrémentent la cour d’entrée.
La disposition intérieure dénote un grand sens pratique. Réfectoire
spacieux et net, sur lequel débouchent les cuisines dont les
installations modernisées sont remarquables. Salles de classe
très vastes et bien organisées. Salles de récréation où l’on
ne mettait pas souvent les pieds, quelquefois en hiver et
encore...
 La superbe chapelle digne des cathédrales, où nous avons
passé tellement d’heures... Au premier étage, le dortoir des
grands avec ses 40 lits alignés en rangs d’oignons et les
lavabos. Au deuxième, celui des petits était du même acabit.
La partie centrale était réservée aux bureaux des pères. Durant
la guerre, les Allemands en prirent possession puis les Américains
jusqu’à la Libération.
La superbe chapelle digne des cathédrales, où nous avons
passé tellement d’heures... Au premier étage, le dortoir des
grands avec ses 40 lits alignés en rangs d’oignons et les
lavabos. Au deuxième, celui des petits était du même acabit.
La partie centrale était réservée aux bureaux des pères. Durant
la guerre, les Allemands en prirent possession puis les Américains
jusqu’à la Libération.
La
chapelle

|
|
Les
anciens qui ont vécu cette période gardent des souvenirs
les plus divers et nous allons comme précédemment, apporter
différents témoignages tout aussi sincères et sans partialité.
|
 Mais avant de parler des
activités et péripéties des orphelins, j’aimerais présenter
une sœur qui a passé tant d’années à Domois et ce, jusqu’à
sa mort. Sœur Alice est arrivée en 1921, elle avait
31 ans. Elle était employée à la cuisine et pendant plus de
trente ans, elle s’est évertuée à satisfaire les ventres des
enfants, toujours insatiables. Il fallait une santé de fer
et un dévouement d’acier, surtout que les 17 dernières années,
elle fit seule la cuisine pour 120 personnes, aidée simplement
de quelques marmitons, qu’elle soignait d’ailleurs comme ses
propres enfants. Cela peut expliquer et excuser que ses plats
laissèrent parfois à “désirer”, comme le souligne notre ami
Robert Cousin qui n’a jamais apprécié sa soupe aux lentilles.
Mais avant de parler des
activités et péripéties des orphelins, j’aimerais présenter
une sœur qui a passé tant d’années à Domois et ce, jusqu’à
sa mort. Sœur Alice est arrivée en 1921, elle avait
31 ans. Elle était employée à la cuisine et pendant plus de
trente ans, elle s’est évertuée à satisfaire les ventres des
enfants, toujours insatiables. Il fallait une santé de fer
et un dévouement d’acier, surtout que les 17 dernières années,
elle fit seule la cuisine pour 120 personnes, aidée simplement
de quelques marmitons, qu’elle soignait d’ailleurs comme ses
propres enfants. Cela peut expliquer et excuser que ses plats
laissèrent parfois à “désirer”, comme le souligne notre ami
Robert Cousin qui n’a jamais apprécié sa soupe aux lentilles.
 Le principal trait de
caractère de sœur Alice était sa grande bonté. Elle était
radicalement incapable d’en vouloir à quelqu’un. Quand le
frère Clep, par exemple, allait lui demander les notes des
orphelins en fin de semaine :
Le principal trait de
caractère de sœur Alice était sa grande bonté. Elle était
radicalement incapable d’en vouloir à quelqu’un. Quand le
frère Clep, par exemple, allait lui demander les notes des
orphelins en fin de semaine :
-
Celui-là, disait-elle parfois, c’est un chameau, un fainéant,
il mérite une très mauvaise note !
- Quelle note voulez-vous que je lui mette ? - Mettez-lui
un huit ! (sur dix)
 Elle les aimait tellement,
ses petits cuisiniers, qu’elle lavait et repassait elle-même
leur linge. Et si l’un d’eux était souffrant, elle le couchait
dans sa réserve et le dorlotait comme une vraie mère.
Elle les aimait tellement,
ses petits cuisiniers, qu’elle lavait et repassait elle-même
leur linge. Et si l’un d’eux était souffrant, elle le couchait
dans sa réserve et le dorlotait comme une vraie mère.
 Les basketteurs rentraient-ils
tard le soir, sœur Alice était encore là pour leur fournir
un bon repas chaud et une friandise supplémentaire, s’ils
avaient bien défendu le drapeau de Domois. Eh oui ! à Domois
il y avait un esprit : le saint bien sûr, mais aussi l’esprit
de corps.
Les basketteurs rentraient-ils
tard le soir, sœur Alice était encore là pour leur fournir
un bon repas chaud et une friandise supplémentaire, s’ils
avaient bien défendu le drapeau de Domois. Eh oui ! à Domois
il y avait un esprit : le saint bien sûr, mais aussi l’esprit
de corps.
 Du matin au soir, elle
était là auprès de sa cuisinière du siècle dernier (avant
la modernisation dont il a été question plus haut). L’après-midi
elle ne s’éclipsait qu’une petite heure, pendant laquelle
d’ailleurs elle allait faire son adoration à la grande chapelle.
La cuisine est faite de travaux pénibles pour une femme. Sœur
Alice s’y entendait comme pas une pour susciter des bonnes
volontés, quand le besoin s’en faisait sentir. Qu’il s’agisse
de découper un quartier de viande ou de déplacer un sac de
ravitaillement, Lucien ne savait pas lui résister.
Du matin au soir, elle
était là auprès de sa cuisinière du siècle dernier (avant
la modernisation dont il a été question plus haut). L’après-midi
elle ne s’éclipsait qu’une petite heure, pendant laquelle
d’ailleurs elle allait faire son adoration à la grande chapelle.
La cuisine est faite de travaux pénibles pour une femme. Sœur
Alice s’y entendait comme pas une pour susciter des bonnes
volontés, quand le besoin s’en faisait sentir. Qu’il s’agisse
de découper un quartier de viande ou de déplacer un sac de
ravitaillement, Lucien ne savait pas lui résister.
La
cuisine

|
 Béthune, Dijon, Domois,
sa vie s’est passée entièrement au service des orphelins.
Nul ne m’en voudra, si je précise même que son grand amour,
j’allais écrire : sa grande passion, fut notre cher Domois.
Elle est décédée à l’âge de 67 ans en 1957.
Béthune, Dijon, Domois,
sa vie s’est passée entièrement au service des orphelins.
Nul ne m’en voudra, si je précise même que son grand amour,
j’allais écrire : sa grande passion, fut notre cher Domois.
Elle est décédée à l’âge de 67 ans en 1957.
|
Deux
sœurs méritent aussi que l’on mentionne ici leur passage,
il vaudrait mieux dire leur installation dans cette
maison qui, à ce que l’on voit, semble ne vouloir jamais
laisser partir ceux qui y viennent, autres que ses orphelins.
|
 Sœur Emma faisait
déjà partie de l’équipe du père Chanlon en 1908. Elle avait,
comme je le disais plus haut, la surveillance de la division
des moyens. Puis un peu plus tard, comme d’autres, elle rejoignit
la salle de couture où il y avait tellement à faire.
Sœur Emma faisait
déjà partie de l’équipe du père Chanlon en 1908. Elle avait,
comme je le disais plus haut, la surveillance de la division
des moyens. Puis un peu plus tard, comme d’autres, elle rejoignit
la salle de couture où il y avait tellement à faire.
 Sœur Rémy était moins
connue des orphelins. Elle a vécu effacée mais ne s’est pas
reposée une minute malgré son âge et ses infirmités. Même
à 88 ans, dans ses dernières années, elle assurait le ménage
et l’entretien de la petite communauté, repliée dans l’aile
droite du château. Elle est partie comme elle a vécu, sans
faire de bruit.
Sœur Rémy était moins
connue des orphelins. Elle a vécu effacée mais ne s’est pas
reposée une minute malgré son âge et ses infirmités. Même
à 88 ans, dans ses dernières années, elle assurait le ménage
et l’entretien de la petite communauté, repliée dans l’aile
droite du château. Elle est partie comme elle a vécu, sans
faire de bruit.
Soeur
Emma et soeur Rémy

|
 Je ne peux ne pas parler,
et tous les anciens ne me démentiront pas, d’une sœur qui
reste dans tous leurs cœurs : sœur Rosalie qui fut
pour les enfants de Domois une véritable maman. Ça y est le
mot est lâché.
Je ne peux ne pas parler,
et tous les anciens ne me démentiront pas, d’une sœur qui
reste dans tous leurs cœurs : sœur Rosalie qui fut
pour les enfants de Domois une véritable maman. Ça y est le
mot est lâché.
 Pour moi, elle était effectivement
la maman qui manquait très certainement à l’enfant de neuf
ans sur qui, arrivant comme tout à chacun dans cette maison
complètement désorienté, elle avait posé un regard non pas
de pitié, mais de grande sympathie, de bonté devrais-je dire.
Pour moi, elle était effectivement
la maman qui manquait très certainement à l’enfant de neuf
ans sur qui, arrivant comme tout à chacun dans cette maison
complètement désorienté, elle avait posé un regard non pas
de pitié, mais de grande sympathie, de bonté devrais-je dire.
 Elle n’avait pas la charge
de surveillance, elle n’aurait pu le faire car elle était
si bonne... mais lorsqu’elle rencontrait les enfants dans
la salle où l’on venait chercher un vêtement, elle ne faisait
aucune différence.
Elle n’avait pas la charge
de surveillance, elle n’aurait pu le faire car elle était
si bonne... mais lorsqu’elle rencontrait les enfants dans
la salle où l’on venait chercher un vêtement, elle ne faisait
aucune différence.
 Elle aimait, j’en suis
certain, tout le monde, même ceux qui faisaient plus de bêtises.
C’est elle qui desservait le réfectoire des pères et des frères.
Ceux-ci mangeaient ensemble, très souvent quelques enfants
aidaient sœur Rosalie à mettre de l’ordre. Ainsi ils pouvaient
“piocher” et manger les restes au fond des plats ! Sœur Alice
s’étonnait parfois que les plats reviennent à la cuisine complètement
vides, mais comme sœur Rosalie, gentille, avec son sourire
de “bonne maman”, elle fermait les yeux.
Elle aimait, j’en suis
certain, tout le monde, même ceux qui faisaient plus de bêtises.
C’est elle qui desservait le réfectoire des pères et des frères.
Ceux-ci mangeaient ensemble, très souvent quelques enfants
aidaient sœur Rosalie à mettre de l’ordre. Ainsi ils pouvaient
“piocher” et manger les restes au fond des plats ! Sœur Alice
s’étonnait parfois que les plats reviennent à la cuisine complètement
vides, mais comme sœur Rosalie, gentille, avec son sourire
de “bonne maman”, elle fermait les yeux.
Soeur
Rosalie

|
|
Il
serait peut-être temps de parler d’une Dame dont le
père Chanlon avait fait la protectrice des orphelins
de Domois. Vous vous en doutez, il s’agit de Notre-Dame
de Domois.
|
 Il serait intéressant
d’en connaître ses origines et les archives de l’abbé Quillot,
curé de Fénay, nous apportent de précieux renseignements.
Il serait intéressant
d’en connaître ses origines et les archives de l’abbé Quillot,
curé de Fénay, nous apportent de précieux renseignements.
 D’où venait cette statue
tellement vénérée depuis d’ailleurs la fin du XIIe, d’époque
romane, cédée indûment par le citoyen Poinsotte à l’église
de Fénay ?
D’où venait cette statue
tellement vénérée depuis d’ailleurs la fin du XIIe, d’époque
romane, cédée indûment par le citoyen Poinsotte à l’église
de Fénay ?
 Taillée dans un bloc de
chêne évidé pour la rendre plus légère, Notre-Dame de Domois
est représentée assise sur un cathèdre, portant l’Enfant-Jésus
sur son genou gauche. Sa main droite tient un sceptre terminé
par une sphère. Elle est chaussée : ses chaussures se terminent
en pointe, le sculpteur en a rabattu les bouts sur le socle.
Par leur forme, ces chaussures rappellent celles qui étaient
en usage vers les Xe et XIe siècles. La ligne générale en
est assez fruste et l’auteur paraît être un artisan imagier
plus qu’un artiste. Les détails de cette sculpture permettent
aux spécialistes d’affirmer qu’elle remonte à la fin du XIIe
ou au début du XIIIe siècle.
Taillée dans un bloc de
chêne évidé pour la rendre plus légère, Notre-Dame de Domois
est représentée assise sur un cathèdre, portant l’Enfant-Jésus
sur son genou gauche. Sa main droite tient un sceptre terminé
par une sphère. Elle est chaussée : ses chaussures se terminent
en pointe, le sculpteur en a rabattu les bouts sur le socle.
Par leur forme, ces chaussures rappellent celles qui étaient
en usage vers les Xe et XIe siècles. La ligne générale en
est assez fruste et l’auteur paraît être un artisan imagier
plus qu’un artiste. Les détails de cette sculpture permettent
aux spécialistes d’affirmer qu’elle remonte à la fin du XIIe
ou au début du XIIIe siècle.
 Le lecteur sera sans doute
content de savoir ce qu’il advint de notre chère Madone, à
partir de la Révolution. M. l’abbé Quillot, curé de Fénay
de 1856 à 1876 (il vivait encore au moment où le père Chanlon
était sur le point de créer l’orphelinat de Domois), dit dans
ses notes, que la statue de Notre-Dame de Domois fut d’abord
placée au-dessus du banc des chantres de Fénay, côté Evangile
(ce qui prouve bien qu’elle venait bien de Domois). Elle fut
ensuite reléguée dans le clocher (au grenier) sans doute à
cause de la laideur de ses formes. Cependant, des connaisseurs
m’ont engagé à la replacer dans l’église, en la faisant repeindre
avec les mêmes couleurs, à cause de son antiquité, et à la
replacer au-dessus des chantres de Saulon-la-Rue. On lui attribue
un miracle. On dit qu’un boiteux, après l’avoir invoquée,
lui laissa sa béquille et s’en retourna guéri. Je tiens ces
détails de la veuve Roussotte, de Fénay, mais tous mes paroissiens
disent qu’elle a fait un autre miracle. C’est une tradition
générale.
Le lecteur sera sans doute
content de savoir ce qu’il advint de notre chère Madone, à
partir de la Révolution. M. l’abbé Quillot, curé de Fénay
de 1856 à 1876 (il vivait encore au moment où le père Chanlon
était sur le point de créer l’orphelinat de Domois), dit dans
ses notes, que la statue de Notre-Dame de Domois fut d’abord
placée au-dessus du banc des chantres de Fénay, côté Evangile
(ce qui prouve bien qu’elle venait bien de Domois). Elle fut
ensuite reléguée dans le clocher (au grenier) sans doute à
cause de la laideur de ses formes. Cependant, des connaisseurs
m’ont engagé à la replacer dans l’église, en la faisant repeindre
avec les mêmes couleurs, à cause de son antiquité, et à la
replacer au-dessus des chantres de Saulon-la-Rue. On lui attribue
un miracle. On dit qu’un boiteux, après l’avoir invoquée,
lui laissa sa béquille et s’en retourna guéri. Je tiens ces
détails de la veuve Roussotte, de Fénay, mais tous mes paroissiens
disent qu’elle a fait un autre miracle. C’est une tradition
générale.

 Au moment de la guerre
de 1870, les femmes de Fénay ont voulu que la Vierge de Domois
sorte du clocher et soit replacée dans l’église. Ce geste
des femmes de Fénay devait trouver immédiatement sa récompense
dans la protection singulière et providentielle dont bénéficièrent
les trois villages de Domois, Chevigny-Fénay, Saulon, au cours
de la guerre de 1870.
Au moment de la guerre
de 1870, les femmes de Fénay ont voulu que la Vierge de Domois
sorte du clocher et soit replacée dans l’église. Ce geste
des femmes de Fénay devait trouver immédiatement sa récompense
dans la protection singulière et providentielle dont bénéficièrent
les trois villages de Domois, Chevigny-Fénay, Saulon, au cours
de la guerre de 1870.
 Ce point d’histoire ayant
été contesté, nous avons de nouveau consulté minutieusement
l’historien qualifié qu’est l’abbé Quillot, curé de Fénay
à l’époque.
Ce point d’histoire ayant
été contesté, nous avons de nouveau consulté minutieusement
l’historien qualifié qu’est l’abbé Quillot, curé de Fénay
à l’époque.
 Sur les 49 mobilisés
de la paroisse (soldats et francs-tireurs) qui participèrent,
entre autres aux batailles de Forbach et Gravelotte, ainsi
qu’au siège de Metz, il y eut deux blessés. Les trois villages
: Domois, Chevigny-Fénay et Saulon furent occupés durant la
période de 1870 à mars 1871, date du départ des derniers Prussiens
; il n’y eut que quelques accrochages verbaux et physiques
mais n’allant jamais mettre la vie des habitants en jeu. Il
était pourtant normal d’avoir peur car les occupants avaient
tous les droits : de piller, massacrer, violer, brûler, c’est
ce qu’a dit le chef d’escadron qui se trouvait là à cette
époque. Pour toutes ces raisons, les paroissiens eurent une
éternelle reconnaissance envers cette Vierge miraculeuse.
Sur les 49 mobilisés
de la paroisse (soldats et francs-tireurs) qui participèrent,
entre autres aux batailles de Forbach et Gravelotte, ainsi
qu’au siège de Metz, il y eut deux blessés. Les trois villages
: Domois, Chevigny-Fénay et Saulon furent occupés durant la
période de 1870 à mars 1871, date du départ des derniers Prussiens
; il n’y eut que quelques accrochages verbaux et physiques
mais n’allant jamais mettre la vie des habitants en jeu. Il
était pourtant normal d’avoir peur car les occupants avaient
tous les droits : de piller, massacrer, violer, brûler, c’est
ce qu’a dit le chef d’escadron qui se trouvait là à cette
époque. Pour toutes ces raisons, les paroissiens eurent une
éternelle reconnaissance envers cette Vierge miraculeuse.
 Depuis 1888 la statue
fut rendue au père Chanlon qui avait préparé pour elle une
magnifique chapelle et reprit cette même année, après une
interruption de près d’un siècle, la tradition du pèlerinage,
le premier dimanche de mai.
Depuis 1888 la statue
fut rendue au père Chanlon qui avait préparé pour elle une
magnifique chapelle et reprit cette même année, après une
interruption de près d’un siècle, la tradition du pèlerinage,
le premier dimanche de mai.
 Le père Chanlon ne se contenta d’ailleurs pas de ramener Notre-Dame
chez elle : il voulut conduire à ses pieds, comme au temps
des Bénédictins de Saint-Bénigne, la foule des pèlerins bourguignons.
Voici le tract d’invitation qu’il prépara pour la circonstance
: “Avant la Révolution, des pèlerinages annuels et nombreux
avaient lieu à Domois pour y honorer la Madone miraculeuse,
Notre-Dame de Domois.
Le père Chanlon ne se contenta d’ailleurs pas de ramener Notre-Dame
chez elle : il voulut conduire à ses pieds, comme au temps
des Bénédictins de Saint-Bénigne, la foule des pèlerins bourguignons.
Voici le tract d’invitation qu’il prépara pour la circonstance
: “Avant la Révolution, des pèlerinages annuels et nombreux
avaient lieu à Domois pour y honorer la Madone miraculeuse,
Notre-Dame de Domois.
 L'orphelinat bâti
avec les matériaux et sur les ruines de son ancien
sanctuaire et gardien de la précieuse statue, veut rendre
à Marie la gloire des jours anciens, et le premier dimanche
de mai renouera dorénavant l’antique tradition des pèlerinages
de Dijon et des populations environnantes”. Cette tradition
se renouait le 6 mai 1888 et n’a été interrompue que pendant
la période des deux guerres mondiales. Ce jour-là, Domois
revêt sa parure de fête et la Vierge est portée processoralement
à travers les allées boisées de la propriété.
L'orphelinat bâti
avec les matériaux et sur les ruines de son ancien
sanctuaire et gardien de la précieuse statue, veut rendre
à Marie la gloire des jours anciens, et le premier dimanche
de mai renouera dorénavant l’antique tradition des pèlerinages
de Dijon et des populations environnantes”. Cette tradition
se renouait le 6 mai 1888 et n’a été interrompue que pendant
la période des deux guerres mondiales. Ce jour-là, Domois
revêt sa parure de fête et la Vierge est portée processoralement
à travers les allées boisées de la propriété.
Le
pélérinage

|
 Pour les orphelins, cette
journée était très belle et les “petits” étaient en première
ligne. La meilleure place en ce qui me concerne était celle
de l’enfant de chœur ; nous étions vêtus d’une aube rouge
et d’une chasuble blanche bardée de jolies broderies au bout
des manches et au bas se rapprochant de celui des prêtres.
Puis quelques “grands” (des costauds) étaient choisis pour
faire fonction de porteurs. La Vierge était mise sur une plate-forme
qu’ils devaient soutenir sur leurs épaules durant une bonne
heure. A la suite venaient les deux sections des petits et
grands et les pères et sœurs de la Maison. Se joignait à nous
la foule de pèlerins qui venaient de toute la région. C’était
par cars entiers qu’ils arrivaient et chaque fois on pouvait
en compter plus de mille. Et nous récitions des dizaines de
chapelets et des cantiques à la gloire de cette Dame qui,
aux yeux de nos protecteurs, le méritait sans aucun doute.
Et nous finissions toujours ce pèlerinage en lui adressant
une dernière fois ce fameux cantique :
Pour les orphelins, cette
journée était très belle et les “petits” étaient en première
ligne. La meilleure place en ce qui me concerne était celle
de l’enfant de chœur ; nous étions vêtus d’une aube rouge
et d’une chasuble blanche bardée de jolies broderies au bout
des manches et au bas se rapprochant de celui des prêtres.
Puis quelques “grands” (des costauds) étaient choisis pour
faire fonction de porteurs. La Vierge était mise sur une plate-forme
qu’ils devaient soutenir sur leurs épaules durant une bonne
heure. A la suite venaient les deux sections des petits et
grands et les pères et sœurs de la Maison. Se joignait à nous
la foule de pèlerins qui venaient de toute la région. C’était
par cars entiers qu’ils arrivaient et chaque fois on pouvait
en compter plus de mille. Et nous récitions des dizaines de
chapelets et des cantiques à la gloire de cette Dame qui,
aux yeux de nos protecteurs, le méritait sans aucun doute.
Et nous finissions toujours ce pèlerinage en lui adressant
une dernière fois ce fameux cantique :
Chez
nous bonne Mère
Chez
Nous bonne Mère
Nous vous aimons tous
Daignez toujours vous plaire
Chez Nous, chez Nous
Avec confiance
Nous disons tous
Malgré nos défaillances
Restez chez Nous !
Douce et Bonne Marie
Entendez notre voix
O Vous Mère chérie
Qui veillez sur Domois.
 Combien de fois l’avons-nous
entonné ? Le frère Clep aimait particulièrement le chanter
Chacun peut penser ce qu’il veut, mais beaucoup peuvent maintenant
après tant d’années se dire que peut être Notre-Dame-de-Domois
les a un peu protégés, comme le père Chanlon le lui avait
demandé en fondant son orphelinat. Combien de fois, nous nous
sommes agenouillés devant cette statue, en maugréant parfois
parce que le temps nous paraissait bien long, parfois aussi
d’une manière très spontanée parce que nous voulions vider
notre cœur dans celui de notre Mère.
Combien de fois l’avons-nous
entonné ? Le frère Clep aimait particulièrement le chanter
Chacun peut penser ce qu’il veut, mais beaucoup peuvent maintenant
après tant d’années se dire que peut être Notre-Dame-de-Domois
les a un peu protégés, comme le père Chanlon le lui avait
demandé en fondant son orphelinat. Combien de fois, nous nous
sommes agenouillés devant cette statue, en maugréant parfois
parce que le temps nous paraissait bien long, parfois aussi
d’une manière très spontanée parce que nous voulions vider
notre cœur dans celui de notre Mère.
Le
pélérinage

|
|
A
la Libération en 1945, le père Helleringer, alors directeur,
entouré d’un bon nombre de pères et frères fait ce qu’il
peut pour que Domois ne se retrouve pas comme en 1920,
lors du départ du père Chanlon.
|
 Les orphelins continuaient
d’arriver et la guerre, les privations ne faisaient qu’accentuer
cette terrible situation. Voici un témoignage de l’un de ces
orphelins, qui malgré les 50 ans qui le séparent des premiers,
ne change pas beaucoup.
Les orphelins continuaient
d’arriver et la guerre, les privations ne faisaient qu’accentuer
cette terrible situation. Voici un témoignage de l’un de ces
orphelins, qui malgré les 50 ans qui le séparent des premiers,
ne change pas beaucoup.
 De la place Wilson, je
pris le tram n° 6, qui devait me déposer au terminus à Longvic
et quittai la route de Seurre pour prendre l’allée de Préville
bordée de sapins. J’apercevais au loin, en haut du chemin,
la masse grise du “château” de Domois.
De la place Wilson, je
pris le tram n° 6, qui devait me déposer au terminus à Longvic
et quittai la route de Seurre pour prendre l’allée de Préville
bordée de sapins. J’apercevais au loin, en haut du chemin,
la masse grise du “château” de Domois.
 J’étais très triste,
car je quittais des parents nourriciers, appelés aujourd’hui
famille d’accueil, que j’aimais beaucoup et qui me le rendaient
bien, me considérant un peu comme leur treizième enfant. C’est
certainement à ce moment-là que j’ai appris à pleurer de l’intérieur,
tout en souriant extérieurement d’un air indifférent.
J’étais très triste,
car je quittais des parents nourriciers, appelés aujourd’hui
famille d’accueil, que j’aimais beaucoup et qui me le rendaient
bien, me considérant un peu comme leur treizième enfant. C’est
certainement à ce moment-là que j’ai appris à pleurer de l’intérieur,
tout en souriant extérieurement d’un air indifférent.
 Il est des peines qui
ne s’extériorisent pas, on a déjà sa fierté d’homme... à 12
ans ! Ce jour-là et peut-être pour la première fois, je pris
conscience que j’étais vraiment orphelin, puisque ma mère
avait décidé de me retirer de cette famille pour me mettre
à Domois.
Il est des peines qui
ne s’extériorisent pas, on a déjà sa fierté d’homme... à 12
ans ! Ce jour-là et peut-être pour la première fois, je pris
conscience que j’étais vraiment orphelin, puisque ma mère
avait décidé de me retirer de cette famille pour me mettre
à Domois.
 En arrivant devant le
grand bâtiment, on s’adressait à la porte de l’aile droite
marquée “concierge”. Un vieil homme dont je ne me souviens
plus du nom, mais qui était l’unique locataire, est venu nous
répondre et nous emmena, ma mère et moi, chez le directeur
qui, à l’époque, était le père Helleringer et dont le bureau
se trouvait dans les vieux bâtiments au-dessus de l’ancienne
chapelle. Quant à moi, on me laissa en bas, à la chapelle,
pour prier pendant que ma mère réglait les formalités d’entrée.
En arrivant devant le
grand bâtiment, on s’adressait à la porte de l’aile droite
marquée “concierge”. Un vieil homme dont je ne me souviens
plus du nom, mais qui était l’unique locataire, est venu nous
répondre et nous emmena, ma mère et moi, chez le directeur
qui, à l’époque, était le père Helleringer et dont le bureau
se trouvait dans les vieux bâtiments au-dessus de l’ancienne
chapelle. Quant à moi, on me laissa en bas, à la chapelle,
pour prier pendant que ma mère réglait les formalités d’entrée.
 Je ne me rappelle pas
avoir beaucoup prié ce jour-là, le cœur n’y étant pas, mais
je me suis bien rattrapé par la suite, car comme nous n’étions
pas nombreux à savoir servir la messe, en latin à l’époque,
nous nous retrouvions souvent de service pour l’office du
matin.
Je ne me rappelle pas
avoir beaucoup prié ce jour-là, le cœur n’y étant pas, mais
je me suis bien rattrapé par la suite, car comme nous n’étions
pas nombreux à savoir servir la messe, en latin à l’époque,
nous nous retrouvions souvent de service pour l’office du
matin.
 On me conduisit dans la
section des “petits” qui se trouvait dans le bâtiment parallèle
à la route de Perrigny, aujourd’hui disparu. Je fis la connaissance
des deux surveillants : père Brousset et frère Charles.
On me conduisit dans la
section des “petits” qui se trouvait dans le bâtiment parallèle
à la route de Perrigny, aujourd’hui disparu. Je fis la connaissance
des deux surveillants : père Brousset et frère Charles.
|
La
période d’avant et d’après guerre fut à Domois assez
bousculée et malgré cela l’œuvre du père Chanlon continuait
à se parfaire. C’est en 1946 qu’une nouvelle équipe
succède à la précédente et nous allons voir arriver
les pères Vai et Buhecker, hommes clés de l’orphelinat.
Ils apportèrent un changement radical et profitèrent
aussi de la disponibilité du château qu’ils occupèrent
en 1947. Mais avant de prendre la direction de l’orphelinat,
ils ont dû commencer à la base comme surveillant des
“petits” concernant le père Vai. Le père Buhecker remplaçant
le père Brousset à l’économat.
|
 Le père Masson,
nouveau directeur, remplace le père Helleringer. Le frère
Clep est remplacé par le père Mathieu et frère Javaux pour
assurer la surveillance des “grands”.
Le père Masson,
nouveau directeur, remplace le père Helleringer. Le frère
Clep est remplacé par le père Mathieu et frère Javaux pour
assurer la surveillance des “grands”.
 Il y avait toujours la
même école, les mêmes jeux, la même soupe, les mêmes corvées,
mais l’esprit de Domois changea. Plus de coups de sifflet
stridents pour le réveil, père Vai tapait dans ses mains.
Le sifflet existait toujours car il fallait bien s’en servir
lors des rassemblements à la fin des récréations, il y avait
un tel “brouhaha”, vous pensez 40 enfants dans une cour...
Mais même le son du sifflet du père Vai nous semblait plus
harmonieux. Nous avions droit de rentrer au chaud en salle
de jeux, quand il faisait vraiment trop froid. Plus de “privé
de manger”, ni d’éternel “piquet”. La méthode d’éducation
avait changé et les enfants obéissaient aussi bien.
Il y avait toujours la
même école, les mêmes jeux, la même soupe, les mêmes corvées,
mais l’esprit de Domois changea. Plus de coups de sifflet
stridents pour le réveil, père Vai tapait dans ses mains.
Le sifflet existait toujours car il fallait bien s’en servir
lors des rassemblements à la fin des récréations, il y avait
un tel “brouhaha”, vous pensez 40 enfants dans une cour...
Mais même le son du sifflet du père Vai nous semblait plus
harmonieux. Nous avions droit de rentrer au chaud en salle
de jeux, quand il faisait vraiment trop froid. Plus de “privé
de manger”, ni d’éternel “piquet”. La méthode d’éducation
avait changé et les enfants obéissaient aussi bien.
 Les pères Vai et Buhecker
: l’un à la direction et l’autre à l’économat.
Les pères Vai et Buhecker
: l’un à la direction et l’autre à l’économat.
 Ils ont été bien aidés
par le père Mathieu, arrivé en même temps comme surveillant
des “grands”. C’est lui qui lança le sport à Domois : basket,
football, athlétisme et cela avec des moyens rudimentaires.
Ils ont été bien aidés
par le père Mathieu, arrivé en même temps comme surveillant
des “grands”. C’est lui qui lança le sport à Domois : basket,
football, athlétisme et cela avec des moyens rudimentaires.
 Ces activités, principalement
le basket, furent reprises par le père économe.
Ces activités, principalement
le basket, furent reprises par le père économe.
La
cour du bas
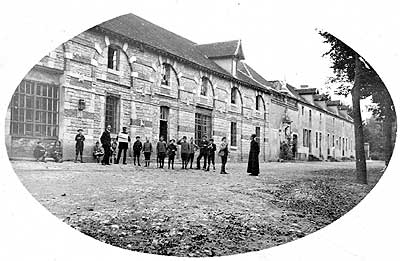
- retour haut -
|
|

